L’enfance et l’adolescence
« Tout homme qui écrit un livre ; ce livre c’est lui. Qu’il le sache ou non qu’il le veuille ou non, cela est. De toute œuvre, quelle qu’elle soit, chétive ou illustre, se dégage une figure, celle de l’écrivain. C’est sa punition, s’il est petit ; c’est sa récompense, s’il est grand. »
Victor Hugo, préface aux œuvres complètes.
Introduction
Les écrits qui vont suivre sont morceaux de mémoire. Ils commencent avec la naissance sans quoi il n’y aurait pas d’écrits. Ils se poursuivent avec l’enfance et l’adolescence qui se construit de la rencontre individualisée avec le monde sans quoi il n’y aurait pas d’identité. Ils se termineront avec la vieillesse qui donne le temps du regard sur ce qui fut.
Je suis arrivé dans un temps et dans un lieu par hasard comme chacun d’entre nous. On ne choisit pas la date ni le lieu de l’atterrissage, pas plus que sa famille. De même les parents ne choisissent pas leurs enfants ou ce qu’ils vont devenir. La vie est un rassemblement aléatoire auquel on tente de donner du sens. A partir de la naissance, il n’y a qu’un seul choix si on veut vivre, c’est accepter les déterminants et œuvrer pour les changer s’ils ne nous conviennent pas. C’est ainsi que s’est construite mon histoire. Elle s’est nourrie des matériaux dont je disposais, petit à petit au fil du temps. Mon seul effort aura été de chercher à lui donner un sens. Nous sommes des machines à construire du sens pour faire humanité. Le monde qui m’environne, même si je peux agir sur lui, ne répond pas à la question : que suis-je pour moi ? C’est aussi répondre à cette question que d’écrire. Je poursuis avec détermination une vie qui est mienne, même si quand on est né au mauvais endroit, il faut beaucoup d’énergie et peut-être plus d’une vie pour en revenir.
Les souvenirs qui ont émergé témoignent que le fils, survivant et non pas unique, orphelin de mère que j’étais, a trouvé dans sa vie à défaut de frères de sang des « aimés aimants » et son âme sœur. Mes souvenirs en s’interpellant feront naître des interrogations ou des explications. Tout cela constitue mon chemin qui n’est pas encore terminé. Mes souvenirs témoignent d’une extrême diversité de curiosités et d’intérêts, mais aussi de cette obsession essentielle, inépuisable, inépuisée qui n’a pas cessé de m’animer : Que puis-je savoir ? Que puis-je croire ? Que puis-je espérer ? Qu’est-ce que l’homme et quel homme suis-je ? Entreprendre d’écrire me met dans une situation chaotique où se réveillent des idées oubliées, des amitiés rencontrées, des hommes ou des femmes qui furent mes héros, mes amis ou mes catalyseurs. « Ils témoignent que je suis devenu tout ce que j’ai rencontré » Edgard Morin.
Que restera-t-il de moi, de mon existence ? Peu de choses sans doute. C’est pourquoi il me faut écrire puisqu’il me faudra partir. Mais que faut-il écrire ? Comment faut-il se dire ? J’ai choisi d’écrire, au risque de ne pas être toujours compris, dans la plénitude de ma pensée plutôt que de chercher à être accepté dans le renoncement. J’ai un début et une fin, je m’inscris dans une histoire de ma propre initiative, comme je l’entends. Je n’attends rien et je me sens parfaitement libre des autres. « Il y a, d’un côté, la vie qui s’écoule avec un commencement et une fin, et de l’autre, la vie qui fait la singularité humaine parce qu’elle peut être racontée. On pourrait ainsi parler de vie biologique etde viebiographique. L’espérance de vie mesure l’étendue de la première, l’histoire de vie relate la richesse de la seconde » Didier Fassin, Leçons Inaugurales du Collège de France.
Écrire c’est s’accepter, c’est consentir à son être par l’écriture et s’offrir aux autres. Il faut qu’on puisse deviner derrière les mots imprimés quelque chose qui n’existerait pas, qui serait au dessus de l’existence, une émergence. A travers cet écrit se rappeler sa vie sans regrets ni répugnance, sinon au passé, du moins au présent. Ce livre de vie ne peut être qu’une sorte de vision littéraire, une purification par l’écriture et la poésie des mots. Tout doit être tiré vers le beau même le plus sordide car dans toute chose il y a naturellement de la beauté
Né dans une famille d’ouvriers déchue et tombée dans une grande pauvreté, j’ai cherché à y échapper socialement et culturellement, refusant « la reproduction » et « le déterminisme social » tel que mis en avant par Pierre Bourdieu. Le changement de classe sociale entendu du point de vue économique et culturel est un processus continu. Pour moi, il s’appuie en particulier sur la recherche permanente de connaissances alliée à un esprit critique sans oublier la solidarité humaine et la révolte contre l’injustice. Les liens aux autres nous forgent et font de nous de bonnes ou de mauvaises personnes. J’écris aussi pour transmettre à mes enfants, mes petits enfants et suivants d’où je viens et par là même d’où ils viennent. Cette démarche d’écriture m’a entraîné bien au-delà de ce que je pensais en me conduisant à rechercher au-delà des souvenirs quelque chose de plus universel. Chantal Jaquet, philosophe, a forgé le concept de « transclasse » dans lequel je m’inscris pleinement.
Mon parcours commence dans la deuxième moitié du 20ème siècle qui a vu un nombre très important de modifications technologiques forgeant à la hâte de nouveaux liens sociaux. Aucune époque n’en a connues autant dans un délai aussi bref. Cela a enthousiasmé mon esprit curieux et inventif. Longtemps épris de technologie, je m’arrête face au Smartphone et au piège de la localisation permanente des individus en attendant leur « puçage ». Je réclame une pause avant que l’humanité ne bascule dans un monde qu’elle ne contrôlera plus mais qui va la contrôler. Les hommes regardent ces technologies fascinés par les « nouveaux jouets » produits au seul profit de l’économie néolibérale, laissant de côté tous les autres aspects qui pourtant remettent en question les rapports humains et in fine, l’économie elle-même.
Dans le même temps, se construit la législation de notre asservissement de demain. Nous devons nous interroger sur la possibilité de vivre libre et heureux, et sur notre pérennité en tant qu’espèce face aux menaces économiques, écologiques et sociétales. Nous pouvons néanmoins être à la hauteur du défit à condition d’en avoir le courage. Pour cela nous devons avoir la sagesse de prendre de la distance avec le confort imaginaire du système dominant et trouver notre place dans le flux du vivant entre nécessité et liberté. Au nom d’une certaine vision de la science on nous a fait croire que le progrès technique conduisait au bonheur. Il est évident aujourd’hui, pour ceux qui veulent le savoir, que c’est faux. Des enfants meurent de mal nutrition, des cohortes d’hommes et de femmes souffrent pour une vie misérable pendant qu’une autre partie dilapide les richesses de la planète.
Rabelais disait « La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme.” Il était le penseur d’une condition humaine modeste, consciente de sa finitude. Sa philosophie reconnaissait une nature humaine faible, mais forte en ce qu’elle avait conscience de sa faiblesse.
Pour laisser une trace, j’ai décidé de faire imprimer mes écrits sous forme de livres, le seul vrai moyen de laisser un témoignage humain en m’ajoutant au collectif des « écrivants ».
« Mais qu’est-ce qu’un livre ? Que sont les livres qui, sur nos étagères, sur celles des bibliothèques du monde entier, renferment les connaissances et les rêveries que l’humanité accumule depuis qu’elle est en situation d’écrire ?… Quels miroirs nous tendent-ils ?» N’espérez pas vous débarrasser des livres Jean-Claude Carrière, Umberto Ecco.
Ceux d’avant
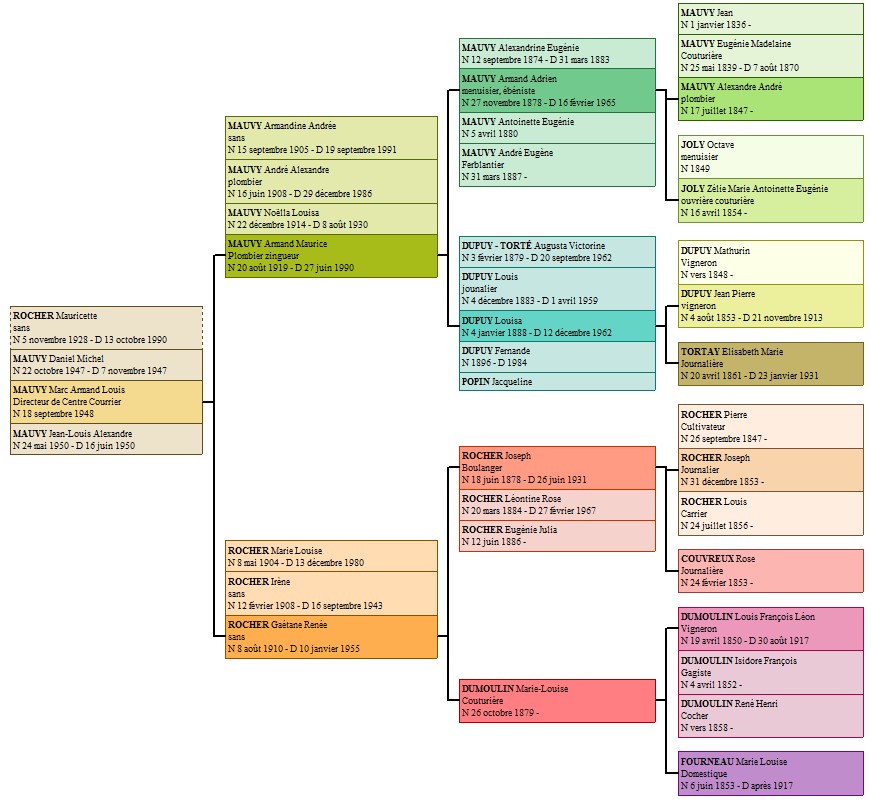
Ma famille paternelle fait partie d’une lignée tourangelle ancienne dont le principal bassin de vie se situe à Amboise. Les recherches généalogiques ont permis de remonter à un Sulpice Mauvy né vers 1640 et marié en 1665 à Amboise. Les métiers exercés vont de fagoteurs à marchands de bois ou menuisiers en passant par passementier et quelques autres. Ils suivent le chemin de la bonne ou de la mauvaise fortune. Mon arrière grand-père Alexandre André Mauvy, a fait la guerre de 1870, il y faisait profession de boulanger. Installé plombier à Tours, il travailla notamment pour l’archevêché. Il était marié à Zélie Marie Antoinette Joly mon arrière grand-mère, issue d’une famille du Loir et Cher. Son père était menuisier et sa mère lingère. Selon le dire de mon père elle était très belle, on l’appelait « Jolie Joly ». Mon père disait que durant sa vie elle n’avait jamais employé autre chose que des cristaux de soude pour se laver, ce qui expliquerait sa très belle peau, une écologiste avant l’heure. Ils ont eu deux filles, Alexandrine, morte à neuf ans, Antoinette et deux garçons André et Armand Adrien, mon grand-père né en 1878 au 13 de la rue de Bordeaux à Tours.
Mon grand-père et les grèves de 1920
A vingt ans Armand Adrien demeurait à Tours, 5 rue Racine, où il travaillait en tant qu’ébéniste, métier qu’il a exercé durant toute sa vie. Entre la rue Racine, la rue Jules Favre et la rue Georges Courteline, il aura vécu sa vie dans un périmètre restreint autour de ce qu’on appelle « la Grande Rue » qui traverse Tours d’est en ouest. Il est mort le 16 février 1965, exilé à la cité des Sables à 6 km du centre ville.
A l’hiver et au printemps 1920, il a 42 ans au moment où un grand mouvement social touche les six compagnies de chemins de fer dont la compagnie Paris Orléans. Il est employé comme chef d’équipe aux Chemins de fer Paris Orléans. Socialiste et syndicaliste, il participe au mouvement de grève par solidarité avec ses camarades simples ouvriers. Il sera révoqué comme au moins 18000 autres cheminots. Par la suite, il sera réintégré comme beaucoup de ses camarades à la Compagnie Générale de Construction et d’Entretien de Matériel de chemin de fer aux ateliers de St Pierre des Corps. Les conditions de travail et les salaires sont moindres, c’est la sanction imposée aux ouvriers grévistes. Il a fini sa carrière chez un ébéniste à l’angle de la rue Georges Courteline et de la rue de la Madeleine à Tours. Son histoire épouse celle des luttes syndicales et des mouvements politiques en Touraine du début du XXème siècle. En 1920, il habite au 16 rue Jules Favre non loin de la salle du Manège où s’est tenu en décembre 1920 le congrès de Tours qui a décidé de la scission entre la SFIO et la SFIC (section française de l’internationale communiste) qui deviendra le PC. Mon grand-père fera le choix du communisme avec les majoritaires. Il disait que tant qu’il n’aurait pas vu les communistes au pouvoir il ne changerait pas d’avis. Je ne sais pas jusqu’à quand il a dit cela. Sa conscience ouvrière l’a sans doute empêché de voir la réalité du mouvement communiste international et la dérive du stalinisme. A notre époque de « grande lessive » on ne manque pas de s’interroger sur l’histoire et ses contradictions, la Révolution de 89, les Lumières, le communisme et bientôt le capitalisme dans une société en effondrement. Qui peut dire qu’il ne s’est jamais trompé?
Ma grand-mère, Louisa Dupuis, est née le mercredi 4 janvier 1888 à Nazelles. Selon l’état civil, elle est la fille légitime de Jean Pierre Dupuis, vigneron, et d’Elisabeth Marie Tortay, journalière. Ils se sont unis le jeudi 23 novembre 1905 à Tours. Leur première fille était née le 15 septembre. Louisa est alors âgée de dix sept ans. Au total, le couple aura quatre enfants : Armandine née en 1905, André né en 1908, Noëlla née en 1914 et Armand, mon père, né en 1919. Ma grand-mère est décédée le 12 décembre 1962, à l’âge de soixante quatorze ans, à Tours. Elle est morte en psychiatrie à l’hôpital Bretonneau, les médecins l’y avaient transférée car elle hurlait de douleur souffrant d’un cancer de l’estomac en phase finale. On était bien loin des soins palliatifs.
« La terre de la grande punition »
La famille Dupuis était une famille de journaliers et de vignerons entre Pocé sur Cisse et Nazelles. Mon arrière grand-père Jean-Pierre Dupuis a épousé Élisabeth Tortay en 1883. Ils ont eu trois filles, Louisa, Augusta, Fernande et un fils, mon grand-oncle Louis Dupuis.
L’histoire de Jean-Pierre Dupuis, mon arrière grand-père, se confond tragiquement avec une infamie de la 3ème République, la relégation en Guyane. Après cinq condamnations pour vol, tentative de vol ou mendicité, Jean-Pierre Dupuis, considéré comme multirécidiviste dont il faut se débarrasser, est envoyé au bagne pour sa dernière condamnation, 6 mois de prison et la relégation. Il allait se retrouver avec les criminels condamnés aux travaux forcés. Il s’agissait pour la 3ème République de se débarrasser de ses petits délinquants récidivistes en les éloignant définitivement par la « relégation » à vie. Les relégués étaient considérés comme une population marginale, jugée irrécupérable. La relégation interdisait tout retour après la peine de prison, on purgeait six mois puis on était là pour toute la vie.
Il embarque le 17 juin 1897 sur le Calédonie qui arrive à Maroni le 9 juillet 1897. Il fera quatre tentatives d’évasion. Il est mort le 21 novembre 1913 à la Léproserie de l’Acarouany près de Mana, en Guyane. Le village était un lieu de soin, mais aussi de quarantaine. Il fallait deux heures de canot depuis Mana pour s’y rendre. Une petite chapelle, des cases en bois et un dispensaire sont érigés là. Les lépreux, tenus à l’écart du reste de la population, meurent à l’abri des regards.
Louis Dupuis
Désireux de rejoindre son père mon grand-oncle Louis cherchera et réussira à se faire condamner à son tour à la relégation. Révolté et réfractaire à l’autorité, il suivra le même chemin vers la Guyane. Petits larcins mais surtout outrage à agent, traité de « vache », et propos antimilitaristes lui vaudront quinze mois de prison et la relégation pour cause de récidive. Succédant à la politique de l’Ordre Moral, la politique de salubrité publique de la 3ème République côtoie l’idéologie d’extrême droite qui domine notamment dans l’armée à cette époque (Affaire Dreyfus).
Les antimilitaristes, les anarchistes, les « apaches » et autres personnes en marge de cette société réactionnaire étaient surveillés et punis dès que l’occasion s’en présentait. Ils étaient les cibles de la police gardienne de l’idéologie dominante.
Des documents relatifs à ces évènements, établis par la Sûreté Générale, ancêtre des Renseignements Généraux, existent encore. Ils proviennent d’archives d’avant 1940. Ces archives ont été saisies et emportées par les allemands en 1940 puis pris par les russes en 1945. Les fichiers de police intéressent tous les pouvoirs. Ces fichiers sont aujourd’hui conservées aux Archives Nationales à Pierrefitte sur Seine, c’est là que ceux concernant Louis Dupuis ont été retrouvés.
La notice individuelle de police transmise à la préfecture indique « Dupuis est non seulement un antimilitariste bien connu, mais aussi un apache des plus dangereux condamné à 15 mois de prison et à la relégation pour outrage à sous-officiers »
Le 9 juillet 1908, il embarque sur le navire le « Loire » et débarque à Maroni le 31 juillet. Il fera une dizaine de tentatives d’évasion dont la 1ère le 27 mars 1913 alors que son père était probablement à la léproserie où il est mort le 21 novembre. Ils n’avaient sans aucun doute plus aucun contact. On peut penser qu’avant le père et le fils s’étaient rejoints et côtoyés de 1908 à 1913.
L’oncle Louis sera finalement tiré d’affaire grâce à une jurisprudence de la cour de cassation en date du 1° avril 1915, confirmée par un arrêt Carrey de la cour d’appel d’Orléans en date du 28 juin 1915 qui décide d’étendre à la peine accessoire de la relégation la « prescription pénale ». Malgré la résistance de l’administration pénitentiaire qui dissimula cette loi au regard des prisonniers et suite à sa dernière évasion en 1916, sa relégation sera prescrite. Il suffisait à un relégué de s’échapper cinq ans du bagne pour voir sa peine prescrite et pouvoir revenir ensuite sur le territoire métropolitain sans être inquiété en quoi que ce soit. D’après les archives il s’évade en 1916 et ne réapparait qu’en 1923 avec la relégation prescrite,
En 1933 il épouse Marie Colette Denise Gabrielle Thorin à Pointe à Pitre en Guadeloupe. Ils rentrent en France assez rapidement. En 1935 ils sont à Paris, ce que confirme une lettre de ma grand-mère datée de juin 35. Ma tante Denise était une guadeloupéenne de couleur, aimable et joyeuse. Enfant, je les ai côtoyés à Paris entre 1950 et 1954. J’ai quelques vagues souvenirs de ce grand-oncle qui se mettait à quatre pattes et me portait sur son dos en faisant le cheval et de ses crises de paludisme qui nous obligeaient à partir rapidement lors de certaines visites. Je n’ai pas eu l’occasion de revoir cet oncle après la mort de ma mère en 1955. Il est décédé à Paris en 1959.
Mon arrière grand-mère Élisabeth a eu une autre fille Victorine, née en 1901 pendant la relégation de son mari. La déclaration de naissance mentionne Jean-Pierre Dupuis comme étant le père de Victorine. S’il en est le père en droit, il ne peut pas être le père biologique puisqu’il se trouvait en Guyane à cette période-là. Victorine aura une fille, la « cousine Jacqueline » élevée en même temps que mon père.
Mes tantes Mauvy
Ma tante Armandine s’est mariée à Julien Hyacinthe Raude qui est mort le 4 mai 1942, je n’en connais pas les circonstances. Ils ont eu deux fils, Lucien et Marcel. né deux semaines après la mort de son père. Armandine n’a jamais beaucoup travaillé, sa sœur Noëlla disait dans des lettres à la fin des années 20 que sa sœur était paresseuse et instable dans son travail. Tout le contraire de Noëlla qui a commencé à travailler dès son certificat d’étude à quatorze ans. La vie n’a pas été généreuse pour Armandine qui a élevé seule ses deux enfants. Quand je l’ai connue, elle était devenue sourde, un problème que ma grand-mère avait à un moindre degré.
Tout le monde la connaissait sous le sobriquet de « Didine ». Elle profitait de son infirmité pour se montrer sans gène. Par exemple, elle s’installait chez le marchand de journaux pour lire les magazines. Les remontrances du marchand n’avaient aucun effet sur elle vu qu’elle n’entendait rien. Une autre de ses manies était de faire déballer et d’essayer les chapeaux dans les magasins et de ne jamais en acheter, ses moyens étant très limités. La tante Didine était une personne très gentille mais qui semblait un peu ailleurs sans doute en raison de son infirmité. Je me souviens qu’elle avait été marquée par l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy le vendredi 22 novembre 1963 à Dallas car elle disait en avoir rêvé quelques jours avant. Étais-ce une prémonition ? Qui peut savoir ?
Ma tante Noëlla est morte à seize ans en mettant au monde son fils André, que le père n’a pas reconnu. Elle a écrit de nombreuses lettres à son frère André de 1927 à 1930. Ces lettres sont une source précieuse de renseignements. Elles dénotent une forte personnalité et un véritable esprit de famille. Noëlla est certainement le lien qui a manqué à l’union et à la stabilité de la famille.
Les lettres de Noëlla permettent de connaître plus en détail le tissu familial à la fin des années 20. J’y apprends que la grand-mère Zélie réside d’abord à Tours chez mes grands-parents, puis à Paris chez son autre fils, André Eugène et sa femme Anna, la tante Nana selon Noëlla. Dans ces lettres on retrouve également « Mimile », Emile Mesguy et sa femme Antoinette, sœur de mon grand-père et leur « gosse », futur ingénieur aux chemins de fer.
Les lettres révèlent aussi des ambitions professionnelles pour répondre aux besoins minimum d’une famille de l’époque. La préoccupation pour une personne du peuple normalement ambitieuse était d’avoir « le certificat d’étude primaire » pour choisir un métier. Pour Noëlla c’était de travailler dans l’imprimerie. Aujourd’hui 85% d’une tranche d’âge a le Bac et ne sais pas trop quoi en faire faute de débouchés de production qui qualifient des métiers plutôt que des emplois de service qui ne sont qu’une forme de domesticité moderne.
Mon oncle André
La vie de mon oncle a été brisée alors qu’il était jeune par de mauvaises fréquentations. A l’âge de dix neuf ans il a été condamné pour vol à cinq ans de réclusion et six ans d’interdiction de séjour. Sa sœur Noëlla sera son principal lien avec la famille, elle lui a écrit chaque semaine de mai 1927 à juin 1930. Le dernier courrier est daté du 10 juin 1930. Noëlla meurt le 8 aout 1930 des suites de son accouchement.
Le courrier aux prisonniers était surveillé et limité à la famille, en particulier en prison centrale. Noëlla avait dû fournir un justificatif d’état civil pour pouvoir correspondre. Certaines informations transmises étaient censurées, chaque lettre comportait un visa de l’administration pénitentiaire. Par ces lettres on apprend qu’après son incarcération il devra faire son service militaire, probablement dans une unité disciplinaire comme le voulait la règle. Par ces courriers il n’aura pas eu connaissance de la grossesse de sa sœur sans doute pour ne pas le tracasser.
Des lettres de ma grand-mère datant de 1935 mentionnent son retour venant d’un pays chaud et son débarquement. Mon père m’avait raconté être allé avec mon grand-père voir André à Port-Vendres. Il en avait le souvenir précis à cause du grand vent qui repoussait littéralement l’enfant qu’il était. Or, Port-Vendres était avant guerre le principal port en lien avec l’Algérie. Sans doute mon oncle a-t-il fait son service militaire dans les Bat’ d’Af’ (bataillons d’Afrique) dont les soldats appelés Zéphyrs puis Joyeux, avaient purgé une peine d’emprisonnement avant leur incorporation.
Les bataillons d’Afrique ne sont pas des unités disciplinaires au sens strict. Cependant, il est clair qu’il y régnait une discipline bien plus forte que dans les autres unités de l’armée. La loi de 1905 dit « sont incorporés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique (sauf décision contraire du Ministre de la Guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison) les individus reconnus coupables de crimes, condamnés seulement à l’emprisonnement » Les bataillons stationnaient dans leurs garnisons d’Algérie ou de Tunisie, situées dans des régions très inhospitalières. L’ambiance y était très dure, par suite du régime, parfois inhumain infligé aux Joyeux. On peut citer les sévices du tombeau où on enfouissait le puni dans le sable la tête seule sortant du trou sous un soleil ardent, ou celui de la crapaudière où le puni était attaché à plat ventre, pieds et mains fixés ensemble derrière le dos. Il s’ensuivit des décès dont la presse s’empara, notamment Albert Londres.
Après son retour, interdit de séjour à Tours, il s’installe à Angers où il se marie en septembre 39 avec la tante Suzanne, sa correspondante pendant son séjour en Algérie. Ma grand-mère s’étonna de la résidence choisie dans une de ses lettres, elle n’était sans doute pas au courant de tout. L’oncle André a ensuite mené une vie sage et exemplaire. Il a eu une situation stable en tant que plombier à la brasserie Saint Éloi de Tours. André et Suzanne n’ont pas eu d’enfants. Dans les années 50, il fut réhabilité. La réhabilitation judiciaire récompense une réinsertion sociale réussie et restitue, à celui qui le mérite, sa dignité de citoyen.
Un côté dans l’ombre, la famille Rocher
De ma grand-mère maternelle, je ne sais rien sinon qu’elle s’appelait Marie-Louise Dumoulin. Mon grand-père Joseph Rocher était boulanger. Le couple Rocher a eu trois filles Marie-Louise, Irène et ma mère Gaëtane. Irène est née le 12 février 1908 et décédée le 16 septembre 1943 à Nantes sous les bombardements, je ne l’ai pas connue. En revanche, jusqu’à l’âge de 6 ans, j’ai bien connu Marie-Louise qui habitait passage de l’Épargne à Paris, la chambre voisine de la nôtre. Elle est née le 8 mai 1904 et décédée à Nanterre en 1980 ce que je n’ai appris que très récemment en faisant des recherches généalogiques. J’ignorais qu’elle vivait encore pendant ma vie d’adulte. Je regrette de ne pas l’avoir su, elle aurait pu m’apprendre beaucoup de choses sur ma mère et la famille Rocher. En 1980 Internet n’existait pas pour retrouver des personnes.
En 1943, Marie-Louise se trouvait en Allemagne. Était-ce pour le STO, travailleuse volontaire ou pour suivre son conjoint ? Je l’ignore.
Mes parents
Mon père, Armand, porte le prénom de son propre père qui l’a déclaré ainsi à la naissance, contre l’avis de sa femme. Je n’ai jamais su si c’est parce que mon grand-père avait un peu arrosé la naissance, s’il avait oublié le prénom voulu par ma grand-mère ou encore si c’était son choix personnel. Toujours est-il que ma grand-mère refusa toute sa vie d’appeler mon père par son prénom. Elle l’appelait « mon biquet » ou « Bibi ». Pour cette raison mon père était connu sous ce sobriquet de Bibi.
C’était un enfant assez doué, semble-il, puisqu’il obtint son certificat d’étude en 1932, il n’avait que treize ans. Il passe ensuite un CAP de plombier-zingueur et devient ouvrier qualifié à dix sept ans. Au recensement de 1936, il habitait chez ses parents avec André, le fils de Noëlla, son neveu. C’est un bel homme de un mètre soixante et onze qui rencontre en 1939 une petite femme, par la taille, dont il tombe amoureux. Gaëtane, ma mère, elle mesurait environ un mètre cinquante.
Le 20 août 1939 il a 20 ans ; le dimanche 3 septembre 1939 à onze heures pour la Grande Bretagne et à dix sept heures pour la France, la guerre est déclarée à l’Allemagne. La première fraction de la classe 39, dont ne fait pas partie mon père, est appelée au service armé. Selon son livret militaire mon père sera incorporé le 15 avril 1940 comme soldat de 2ème classe au 9ème régiment des tirailleurs. Le Maréchal Pétain fait signer l’armistice le 22 juin 1940. Le 1er août 1940 mon père est réaffecté à Agen, au 150ème Régiment d’Infanterie recréé dans l’armée d’armistice. Le régiment est dissous le 28 novembre 1942 à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, l’Armée d’armistice cesse d’exister.
Selon la version officielle mon père est démobilisé et « se retire » à Tours 28 rue Duchesne. En fait, il s’était déjà démobilisé tout seul, il est déserteur de l’armée de Pétain, il est en cavale depuis août 1940. Le 21 mai 1942 il sera condamné par le tribunal de St Nazaire à quatre mois de prison pour vagabondage et vol d’un lapin, puis le 21 août 1942 par le tribunal de Tours à six mois d’emprisonnement pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. Libéré, le 25 février 1943 il reçoit son télégramme pour partir travailler en Allemagne dans le cadre du STO. « Vous êtes désigné pour partir travailler en Allemagne veuillez vous présenter à la feldkommandantur de Tours le vendredi 26 février à 9 heures ». Sur son télégramme mon père a inscrit « réfractaire» et s’est fondu à nouveau dans l’anonymat de la France de cette époque. Cet acte aurait pu avoir des conséquences dramatiques puisque l’occupant n’hésitait pas à exercer des représailles, les réfractaires, s’ils étaient repris, étaient déportés dans des camps de travail et la famille pouvait être menacée. Comment a-t-il vécu de février 1943 à mai 1945 ? Sans doute comme les 200 000 autres jeunes qui refuseront d’aller travailler en Allemagne. Certain ont gagné le maquis, d’autres se sont cachés. Mon père n’en parlait jamais.
Le refus est un des premiers actes de résistance possible il s’oppose au consentement. J’ai retrouvé mention de son statut de réfractaire sur son rappel de carrière pour la retraite, « réfractaire du 21/04/1943 au 16/11/1944 », la seule reconnaissance officielle de son acte de résistance. Mon père a refusé à cette époque l’armée de Pétain et le STO par conviction personnelle. Il aurait pu en tirer avantage après la Libération. Certains se sont faits valoir pour beaucoup moins que cela, mais ce n’était pas dans sa nature ni dans le fil de l’histoire anarchiste d’une partie de la famille.
La guerre prend fin et il est remobilisé pour finir son temps. Il garde les prisonniers allemands chargés du déminage. De cette époque il garde quelques souvenirs plus ou moins bons, comme ce cadeau d’un coffret en bois avec la croix de lorraine fabriquée par un prisonnier et que j’ai encore. Un autre moins bon quand il a dû tirer sur un prisonnier qui tentait de s’évader.
Mes parents s’étaient connus en mars 1939 d’après les dates au dos des photos. Ma mère était plus âgée de neuf ans et avait une fille, Mauricette née en 1930. Ma grand-mère paternelle, Louisa, était farouchement opposée à ce couple. Elle vénérait mon père et détestait celle qui lui prenait son fils. Elle fera tout pour casser le couple. Ma mère a écrit au dos d’une photo sur laquelle mon père est avec ses parents « cette femme qui a brisé ma vie » en parlant de ma grand-mère.
Ma mère, Gaëtane est née à Savonnières en Indre et Loire le 8 août 1910. Je ne sais rien de sa vie avant sa rencontre avec mon père. Elle a vingt huit ans et une fille de dix ans, Mauricette, lorsqu’ils se rencontrent. C’est le grand amour. Le goût du chant fait sans doute partie de leur histoire. Elle chante avec la voie d’Edith Piaf et lui avec celle de Tino Rossi. Elle est musicienne, elle joue du violon et à l’occasion de l’accordéon. Pendant les années de guerre je n’ai pas d’information sur sa vie quotidienne. Elle est seule avec un compagnon en cavale et une fillette de dix ans. Pendant la guerre ils seront séparés, mon père est en cavale entre Tours chez ses parents et St Nazaire ou Nantes. Ma mère est avec sa fille Mauricette, je n’ai pas d’information sur sa vie quotidienne. Peut-être se sont-ils vus à Nantes chez ma tante Irène, la sœur de ma mère, jusqu’au décès de celle-ci en 1943 sous les bombardements.
Mes grands-parents habitaient à cette époque 77 rue Georges Courteline à Tours, ma mère a pu y résider un peu, Mauricette avait des souvenirs de l’occupation en commun avec mon cousin André né comme elle en 1930. Je l’ai entendue évoquer leurs aventures d’adolescents à la recherche de nourriture. Mais cela ne veut pas dire qu’ils habitaient ensemble.
Après la guerre mes parents ont repris une vie commune pour fonder une famille. Ils ont habité à Sainte Catherine de Fierbois en Touraine où ils se sont mariés le 11 octobre 1947, onze jours avant la naissance de mon premier frère Daniel qui ne vivra que dix huit jours. Mes parents en ont eu beaucoup de chagrin, cela m’a été rapporté par Éliane, la première femme de mon cousin André, qui les a vus pleurer. Ils s’étaient installés à la campagne car mon père avait pour projet de démarcher les fermes à vélo et d’offrir ses services pour réparer les casseroles et autres objets en métal. L’après guerre et le manque de tout favorisait la réparation. Il aurait pu aussi exercer son métier de plombier-zingueur et devenir artisan. Mais ma mère avait donné leurs quelques économies destinées à l’achat du matériel à Mauricette, pour son installation, à la naissance de sa fille Irène. Le projet est tombé à l’eau. Il n’était plus utile d’habiter la campagne. Ils ont donc déménagé pour Tours chez mes grands-parents, puis pour Saint Pierre des Corps. Ma naissance l’année suivante sera leur premier vrai bonheur.
Certaines personnes sont marquées par le malheur, ma mère aura été de celles là. Mauricette, était le fruit d’un viol, peut-être d’un inceste. En tout état de cause, ma demi-sœur est née de la brutalité d’un homme. Je hais la violence faite aux femmes. J’imagine à peine la difficulté de vie d’une fille-mère à cette époque. L’idée de sa pauvre vie et le manque de sa présence au cours de mon enfance me sont une souffrance durable. Les mots existent qui cicatrisent certaines blessures, mais ils laissent malgré tout un vide de douleur permanent.
De 1939 à 1955 mes parents auront connu cinq ans de galère pendant la guerre, perdu deux enfants à la naissance en 47 et en 50, et pour finir, basculé dans l’épreuve de la maladie à partir du début de 54. Ma mère s’est éteinte le 10 janvier 1955 après plusieurs mois de maladie et de souffrance. Je me réconforte en me disant qu’ils ont eu quelques moments de bonheur et qu’une grande partie de ces moments leurs a été apporté par ma présence. Je pense en avoir été conscient très tôt, le lien à mes père et mère repose sur ce bonheur perdu et sur l’amour qui nous unissait. Ce lien est très fort, c’est pour cela qu’ils sont toujours à mes côtés et que quelquefois je me prends à penser qu’ils veillent encore sur moi. Dans les moments difficiles je les invoque en esprit et leur demande de veiller encore sur moi et sur les miens.
Ma venue au monde
Juste quelques instants avant ma naissance, lui appuie sur les pédales et elle, sur le cadre du vélo, gère ses douleurs, C’est mon premier voyage en vélo du 77 de la rue Georges Courteline au 34 de la rue d’Entraigues où je suis né à la clinique d’accouchement chez Madame Nivert. Ma naissance fut difficile, mon père m’a rapporté que j’ai du être ranimé à coup de tapes sur les fesses, j’étais tout bleu à la sortie. Cela a dû être une nouvelle épreuve et une grande peur en raison du décès de mon frère Daniel l’année précédente. A la naissance j’étais déjà un survivant, je le serai encore plus en 1950 avec la mort à trois semaines de mon second frère Jean-Louis. Je suis le survivant, celui qui allait éclairer pendant quelques années la vie de ces deux âmes amoureuses jusqu’à ce que le malheur revienne.
Il m’est difficile de reconstituer avec exactitude l’histoire de mes parents. Ma mère est décédée quand j’avais six ans et je me suis trouvé éloigné de mon père pendant les quatre années qui ont suivi. Durant cette période j’étais en pension chez ma demi-sœur, Mauricette, qui ne m’a jamais parlé de rien. Elle ne s’entendait pas bien avec mon père et pour cette raison, elle évitait d’évoquer le couple de mes parents. De plus j’étais un jeune enfant à peine en âge de comprendre. Je crois surtout qu’évoquer notre mère lui était trop pénible. Par la suite, mon père ne m’a jamais parlé de ma mère pour éviter des scènes de ménages avec une seconde femme jalouse de sa vie antérieure.
Mon petit paradis
« S’il regrette sa petite enfance, c’est qu’on le déchargeait alors du souci d’exister, c’est qu’il était totalement et luxueusement objet pour des adultes tendres, grondeurs et plein de sollicitude, c’est qu’il pouvait alors – et seulement alors – réaliser son rêve de se sentir enveloppé tout entier par un regard » Baudelaire par J.P. Sartre
La petite enfance est l’époque de la découverte du monde et de l’apparition de la conscience, cette relation qu’un être est capable d’établir avec le monde où il vit et avec lui-même. Seul avec mes parents et coupé des autres enfants, la connaissance, l’émotion, l’existence, l’intuition ou la pensée prennent un tour particulier. Ma conscience a pris racine dans une pauvre chambre d’hôtel qu’habitaient mes parents à Paris dans le 19ème arrondissement et dans la solitude d’un enfant unique baigné de leur amour.
Après le décès de mon frère et l’échec de papa « auto entrepreneur » avant l’heure, ils décident d’aller tenter leur chance à Paris. Nous allons habiter à deux pas des Buttes Chaumont, passage de l’Épargne, au n°10. Le passage se situait entre la rue de Crimée et l’avenue Jean Jaurès. Il a été supprimé pour faire place à des immeubles modernes. Le propriétaire était un algérien comme une partie des habitants de l’hôtel. Le passage de l’Épargne était assez sordide. Je ne souviens pas y avoir eu des amis de mon âge. L’environnement social ne favorisait pas les fréquentations.
Voici ce qu’on en dit en 1909, « Nous visitons encore les impasses Paynet et Langlois qui donnent place Hébert (La Chapelle), dans le quartier de la Villette, l’impasse de Joinville et le passage de l’Épargne, cloaques fétides qui, la nuit, se transforment en coupe-gorges » L’Humanité. 20 mai 1909.
Ou encore selon le récit d’une petite fille en 1939 « Nous demeurions dans le 19ème arrondissement, passage de l’Épargne, au numéro 5. Un passage qui allait de l’avenue Jean Jaurès à la rue de Crimée. J’allais à l’école juste à côté, rue Philippe de Girard. Dans la classe, beaucoup d’élèves avaient un surnom. Le quartier était très mélangé. Ma voisine, italienne, ainsi que son frère étaient les « macaronis ». Il y avait aussi les petits arabes. Les parents tenaient un café dans le passage et eux, c’étaient les « bicots » et moi, j’étais la « petite youpine » Tous ces adjectifs ne nous gênaient pas, antisémitisme nous ne connaissions pas. ».
Lorsque nous sommes arrivés là, le passage n’avait pas tellement changé, c’était toujours le même lieu. Le « café des bicots » de 1939 c’était peut-être notre hôtel puisqu’il faisait aussi café. Ce lieu fut malgré tout un lieu de bonheur pour moi dans l’insouciance enfantine de mes trois à cinq ans.
Le logement était constitué d’une seule pièce. On y trouvait un lit, une commode, un coin lavabo, un poêle, une table et des chaises. Je dormais dans le lit de mes parents, à leurs pieds. Les occupants du logement, Gaëtane, Armand, Marc et au début Blacky le chien briard vivaient en harmonie. Plus tard Blacky sera sacrifié par manque de place et sous pression du propriétaire qui n’osait plus se présenter à cause du chien qui lui faisait peur. Le chien briard est un gros chien au poil long assez impressionnant. Pendant les quelques mois passés avec nous, les toits de Paris, en accès à partir de la fenêtre, lui serviront de lieu de promenade et de toilettes à chiens. Mais c’était le chien ou la rue, mon père a du le faire piquer.
La reconstruction après guerre prend du temps et la situation de l’habitat est déplorable. Bien des gens habitent en hôtel dans des chambres meublées. Cependant, ils sont favorisés car d’autres familles sont en bidonvilles ou même couchent dans la rue. Le passage est un lieu à l’écart où vivent essentiellement des immigrés d’Algérie et des familles françaises pauvres et sans autres possibilités de logis
De l’autre côté de la cloison de notre chambre meublée, il y avait une autre chambre où habitait ma tante Marie-Louise que j’appelais gentiment tata « dingue-dingue » en raison des cris qu’elle poussait lorsque son mari la frappait. L’oncle René n’était pas un mauvais bougre mais il buvait toute la journée des bols d’eau et de vin sucrés, ça finissait quand même par faire beaucoup d’alcool, d’où les cris de tata « dingue-dingue ». Je l’aimais bien, ma tante, elle aussi m’aimait bien, elle n’avait pas d’enfants. J’ai appris assez récemment qu’elle est décédée en 1980 à Nanterre. Les informations aujourd’hui accessibles par Internet et le goût de la généalogie permettent ce genre de découverte. Dans ma mémoire d’enfant ma mère était disparue et ma tante avec elle, la mémoire s’installe comme cela et on fait souvent avec. Ma tante est tombée dans l’oubli par inadvertance de ma part et je le regrette. Un lien se brise et le reste suit ; pendant mes années de jeune adulte j’avais bien autre chose à faire mais cela me trouble.
Pour occuper mes journées, j’avais à ma disposition quelques jouets ce que bien des enfants pauvres à l’époque pouvaient m’envier. Parmi ces jouets je me souviens d’un bus mu par un ressort à clé et dont le chauffeur sortait régulièrement la tête par la fenêtre, un beau système d’engrenages. J’étais assez habile à démonter mes jouets, pour les remonter c’était autre chose. J’attendais avec impatience que mon père rentre du travail pour le voir les réparer. J’ai toujours admiré son habileté manuelle, il savait tout faire de ses mains. J’avais aussi le journal de Mickey et un album « Bambi » que je feuilletais pendant de longs moments. C’est ainsi que j’ai appris à lire seul, c’est à dire à reconnaître les mots.
J’étais en très bonne santé, soutenu par un peu de vin sucré en guise de fortifiant ce qui était fréquent en ce temps là. Pour la nourriture je me souviens bien du pain frotté à l’ail et des tartines de saindoux en guise de beurre ; le beurre c’était pour les riches. Toutes mes journées se ressemblaient. Je passais le plus clair de mon temps à la lecture et au démontage des jouets quand je n’allais pas me promener avec ma mère.
La petite voisine part pour l’orphelinat
Dans la sérénité de notre petite famille, papa, maman et moi, un épisode d’injustice m’a particulièrement frappé. A l’étage du dessous vivait une famille, les parents et plusieurs enfants, trop sans doute, bien que je ne sache plus combien. Un jour, grâce aux bons soins d’une assistante sociale, le retrait de l’ainée a été décidé. On vient, elle crie, hurle et se débat mais elle est tout de même emportée. J’imagine, vers un lieu de l’assistance publique de type orphelinat comme cela existait à l’époque. Mes parents en parleront, mon père tonnant que jamais une assistante sociale ne mettra les pieds chez nous, cela me rassure. C’est sans doute à partir de ce moment qu’est née ma défiance à l’égard d’un système social qui ignore les liens d’amour.
Plus tard, c’est le 14 juillet sous un soleil éclatant aux Champs Élysées, je suis juché sur les épaules de mon père et je vois les enfants de l’assistance publique vêtus de coton blanc dans le défilé. Ils jouent à descendre puis à remonter et descendre encore des camions bâchés durant la cérémonie dans le long fleuve des armées de la République. Je n’ai pas aperçu ma petite voisine, il y a tellement d’enfants abandonnés ou retirés à leurs parents. Il est fort mon père, je serre sa tête dans mes bras, je suis rassuré mais je suis triste pour ma voisine. Le soleil est au rendez-vous et je découvre le monde. Je mesure ma chance, bien en sécurité. Plus tard à l’adolescence, je verrai à nouveau partir des enfants retirés à leurs parents et je serai toujours bien content de ne pas en être. Ce drame de l’enfance séparée me poursuivra longtemps. Plus tard après mon retour auprès de mon père, entre la vie difficile dans un milieu de type cour des miracles et la séparation, je me trouverai bien heureux de ne pas être abandonné.
La vie passage de l’Épargne et mes frasques
Le passage de l’Épargne allait de la rue de Crimée au boulevard Jean Jaurès en faisant un coude. Dans le passage je crois me rappeler qu’il y avait plusieurs commerces, notre hôtel, une boulangerie, un bougnat, c’est là qu’on se fournissait en boulets de charbon lorsqu’on en avait les moyens, et un café à la sortie sur le boulevard Jean Jaurès.
Le bougnat ou Auvergnat de Paris, est un immigrant installé à Paris, originaire d’Auvergne, Après avoir exercé la profession de porteur d’eau, notamment pour les bains dès le XVIIe siècle, à partir du XIXe siècle, ils vont s’orienter progressivement dans le commerce du bois, du charbon (livré à domicile), des boissons (vin, spiritueux, limonade), dans l’hôtellerie. Cette reconversion se fit sous le Second Empire, quand le réseau d’alimentation en eau de la capitale commença à desservir les étages des immeubles. Ils forment au XIXe siècle et dans le premier tiers du XXe siècle la communauté immigrante la plus importante de Paris.
La vie dans le passage n’était pas toujours très paisible mais lorsqu’on est enfant on s’habitue et le quotidien devient une espèce de jeu. Le jeu des hommes qui se poursuivent sur les toits, ils jouent aux gendarmes et aux voleurs. Dans la rue le danger est permanent et la vie peut ne tenir qu’à un fil, celui par exemple d’un livreur de boisson qui me maintient sous son camion alors que des coups de feu s’échangent. Ou encore, ce jour où je fus bousculé par un homme poursuivi, dans la chute j’y ai laissé une dent. Tous les anciens du passage qui me connaissaient, comme pour s’excuser de cette mauvaise manière, affirmèrent que l’homme n’était pas du quartier. Un autre jour je vis un homme le visage en sang et je relatais avec insistance à mon père avoir vu « un peau rouge » , c’est ainsi qu’on représentait les indiens d’Amérique dans mes livres d’images. Quelques temps et quelques renseignements plus tard mon père finit par comprendre mon insistance. Un homme s’était fait balafrer au couteau. Il avait le visage en sang, j’étais convaincu de ce que je disais et je n’avais pas tout à fait tort. Le visage était celui d’un « visage pâle » mais la peau était bien rouge.
J’étais identifié et bien accepté par les algériens adultes, en particulier les anciens qui appréciaient ma politesse différente de l’effronterie des autres garnements. Je suivais en cela les conseils de mon père qui n’avait pas de cesse de me dire de toujours être poli, de bien me comporter et de respecter les règles. Il fallait aussi toujours être bien coiffé. Mon père mettait un peu de salive dans ses mains pour tenir mes cheveux, il appelait ça « le baume de mon cœur ». Mon attitude conforme me valait de temps en temps une petite pièce pour acheter des bonbons de la part des vieux arabes. C’était plutôt encourageant d’être poli et gentil. Je faisais aussi les courses pour la maison, pain et petite alimentation. Pour ces dernières j’allais à une épicerie rue de Crimée avec un papier sur lequel étaient inscrit ce que je devais rapporter.
Un jour je devais aller chercher des saucisses à cette épicerie, ce que je fis. Mais, saisi par la gourmandise, je décidais d’acheter avec la monnaie des « caramels à un franc », d’avant 1960. A ce moment là, je suis dans la tentation de gourmandise, j’en perds toute raison et je demande à l’épicière de transformer la monnaie en caramels. Devant son étonnement j’insiste, elle s’exécute, pas très convaincue. En sortant je déguste mes caramels, un à un cela prend un certain temps. Puis, fini les caramels, vient l’heure de la lucidité. Qu’ai-je fait ? Je n’ose pas rentrer chez moi. Je tourne et retourne tout cela dans ma tête et j’en viens à décider de ne pas rentrer. En guise de réconfort j’entame même les saucisses, il faut bien survivre. Pendant ce temps s’inquiétant de mon retard, mon père est parti à ma recherche et finit par me trouver caché derrière un arbre. Ma fugue n’aura pas duré très longtemps et je m’en tire plutôt bien avec peu de reproches. Compte tenu de la peur qu’ils ont eue, mes parents se montrèrent très cléments.
Des bribes de vie me reviennent en mémoire sur ma mère et notre complicité. Elle me gardait précieusement auprès d’elle, pas d’école maternelle ni de garde étrangère quelconque, c’était chaque jour ma main dans la sienne. Nous allions ensemble faire les quelques courses d’alimentation nécessaires. C’est sur les empilements de boîtes de conserves que j’ai appris à compter en faisant attention de ne rien renverser, pas comme cette fois où je me suis retrouvé assis dans une caisse d’œufs.
Ma mère était musicienne, elle jouait du violon et aussi de l’accordéon. Je me souviens précisément d’un arrêt au café au coin du passage de l’Épargne et de l’avenue Jean Jaurès où elle joua avec un beau succès sur l’accordéon d’un artiste de passage. J’ai peu d’autres souvenirs de ma mère, les souvenirs s’entretiennent sinon ils disparaissent, personne ne m’a aidé à les entretenir.
Mon père travaillait, comme il l’a toujours fait lors de son séjour parisien jusqu’en février 1958. Aller chercher papa à son travail est une occupation merveilleuse pour les enfants dans leur jeune âge. Chaque fois c’était une fête, il y a tant de découvertes à faire, en premier lieu le monde personnel de papa celui où il est toute la journée. Je me souviens être allé le chercher lorsqu’il travaillait dans une fabrique de chauffe-eaux du côté de la porte Maillot. A notre arrivée, j’avais eu du mal à le reconnaître recouvert de projections dues à la métallisation. Avant ce jour, c’était transparent car mon père qui a toujours eu grand soin de sa personne se lavait et se changeait avant de revenir chez nous. L’atelier sera victime d’un incendie et mon père à la demande son employeur viendra de nuit brûler au chalumeau des chauffe-eaux rebutés pour augmenter le versement de l’assurance. C’est un souvenir que je n’ai pas réussi à vérifier. Sur le chemin du retour ou lorsque nous étions en promenade je m’évertuais à courir après les pigeons. On m’avait dit que si on leur mettait du sel sur la queue on pouvait les apprivoiser. J’étais fasciné par les amples mouvements des groupes qui s’envolent pour se poser un peu plus loin c’était déjà une récompense mais je n’ai jamais réussi à en apprivoiser un.
Certains dimanches nous allions à la campagne chez un collègue de travail en banlieue, à Vigneux sur Seine. Le dernier emploi de mon père à Paris, en février 1958, avant de revenir à Tours a été dans la société Auer qui fabriquait des appareils de chauffage, elle existe encore.
Nous faisions très régulièrement des promenades au jardin des Buttes Chaumont, au square à côté du métro Stalingrad ou le long du canal de l’Ourcq. Le canal de l’Ourcq avec le canal Saint-Denis, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin, constituent le réseau des canaux parisiens. À l’origine, le canal avait pour premier objectif d’alimenter Paris en eau potable. Dans les années 50 il était parcouru sur toute sa longueur par les « flûtes d’Ourcq », péniches adaptées au petit gabarit de la plus grande partie du canal. La circulation des péniches faisait rêver au voyage. Aujourd’hui c’est un axe vert et on y fait des activités de loisirs, cyclotourisme et la randonnée pédestre. Ma tortue, du moins ce qu’il en reste, repose au bord de ce canal. Après la disparition du regretté Blaky mes parents m’avaient acheté une tortue ça prend moins de place, malheureusement elle n’a pas survécu longtemps, peut-être à cause du fait qu’elle ne pouvait pas aller se promener sur les toits comme notre chien.
Les Buttes Chaumont
Le parc des Buttes-Chaumont est un jardin public de près de vingt cinq hectares, c’est l’un des plus grands espaces verts de Paris. Ce jardin imite un paysage de montagne avec rochers, falaises, torrents, cascades, grotte, alpages, belvédères. C’était pour moi un merveilleux endroit plein de découvertes, tout un décor fascinant pour l’imaginaire, peuplé d’oiseaux de toutes sortes à deux pas de chez moi.
Le parc me faisait rêver et le rêve peut quelquefois vous entraîner dans l’aventure. C’est ainsi que j’ai fait une fugue. Il court, il court le bambin qui va au jardin. Ce jour là, la promenade aux Buttes Chaumont n’était pas au programme et j’en étais très mécontent. Je décidais alors de m’y rendre seul. Je demandais à descendre jouer dans le passage, promettant de ne pas m’éloigner. Mais l’intention préméditée me conduisit à prendre seul le chemin des Buttes Chaumont.
Je sors du passage vers le boulevard Jean Jaurès je descends dans le métro Laumière et je ressors en face côté de l’avenue Laumière. Après c’est tout droit en haut, facile. Mais le problème c’est que le temps passe vite et que l’absence finit par être remarquée. Mon père part à ma recherche, avec une petite idée. Il connaît mon entêtement. Il se renseigne au passage à la mairie de l’avenue Laumière où l’agent de faction lui confirme avoir vu passer un bambin. On remarquera qu’à l’époque la société sécuritaire n’était pas d’actualité. Il n’y avait rien d’anormal à la promenade solitaire d’un enfant en bas âge. Lorsque mon père m’a retrouvé j’étais sur le retour fort satisfait de ma promenade. Mon père me pardonnera facilement à nouveau, trop heureux de m’avoir retrouvé.
L’hiver 1954
Lors de la première semaine de l’année 1954, une première vague de froid accompagnée de chutes de neige s’abat sur le nord et le nord-est de la France. Les températures descendent en dessous de −10 °C ; on relèvera −16 °C à −18 °C dans l’est et même jusqu’à −30 °C à dans le Bas Rhin. Fin janvier, début février, c’est une seconde vague de froid qui concerne cette fois toute la France. Les principaux cours d’eau gèlent et, à Dunkerque une banquise se forme. On enregistre jusqu’à −25 °C à Luxeuil les Bains, −21 °C à Mulhouse, −13 °C à Paris. Le 5 et le 6 février, une tempête de neige s’abat sur le Languedoc-Roussillon ; en deux jours, il tombe 85 cm de neige à Perpignan, 40 cm à Carcassonne et 30 cm à Montpellier.
La rigueur extrême des températures amènera l’abbé Pierre à pousser à la radio son fameux cri d’alarme que l’histoire retiendra sous le nom de « Appel de l’abbé Pierre » . Cet appel provoquera un afflux massif de dons et fera connaître aux Français le Mouvement Emmaüs, créé en 1949, alors en plein développement. Pendant l’hiver 54 en janvier-février, mon père brûla ses vêtements et l’intérieur de la commode pour nous réchauffer. Nous avions la chance d’être abrités dans un immeuble, ce n’était pas le cas de toutes les familles.
La fin de l’insouciance
Mais en cette année 1954, un autre drame se profilait, ma mère était atteinte d’un cancer de l’utérus qui allait l’emporter en à peine un an. Mon père travaillait beaucoup pour nous faire vivre et payer les frais de médecins. La prise en charge des frais médicaux n’existait pas comme aujourd’hui. Il n’y avait pas de carte vitale, il fallait payer les frais puis se faire rembourser. Ceux qui ne pouvaient pas avancer les frais devaient renoncer à se soigner. Dans les années 50 Villejuif était le centre de recherche sur le cancer le plus avancé, mon père y emmena ma mère pensant pouvoir la sauver. Rien n’y fera. De cette époque date ma méfiance à l’égard de la médecine qui promet beaucoup mais ne sait pas tout et ne sauve pas toujours. J’ai rêvé à plusieurs reprises d’une assemblée de médecins costumés et cravatés autour d’une table qui condamnaient ma mère.
Au printemps 54, nous fûmes, en raison de la santé de ma mère, tous les deux envoyés à la campagne à Paizay le Tort dans les Deux Sèvres, au lieu dit la Grelière chez ma sœur Mauricette. L’été 54 à Paizay le Tort était radieux, papa était avec nous pendant quelques jours, maman et moi dans les prés, j’ai encore quelques photos. J’étais heureux ne comprenant pas le drame qui se jouait. Mon père nous quitta pour rentrer à Paris.
On m’inscrivit à l’école. C’était ma première rentrée en septembre 1954. Je savais déjà lire un peu. Je savais compter aussi. J’étais instruit, je devins rapidement un des meilleurs élèves. L’institutrice s’appelait Madame Hutin, une femme sévère et brutale.
Le 10 janvier 1955, maman est morte.
« On n’est pas orphelin d’avoir perdu père et mère, mais d’avoir perdu l’espoir. » Proverbe malien
Le jour de l’enterrement on m’a laissé à la maison, les adultes sont partis. Il fait gris et il tombe une mauvaise pluie, je m’en souviens car je ressens encore cette solitude. Pourquoi suis-je là sans mon père ni ma sœur? Tous sont partis, pourquoi mon père ne m’a-t-il pas emmené ? Ce n’est que quelques temps plus tard que j’ai appris la vérité par ma nièce d’un an mon ainée, c’était dans l’écurie aux chèvres. Elle m’a dit, « ta maman est morte », elle aurait pu dire grand-mère est morte, non, elle a dit « ta maman est morte », comme si cela ne la concerné pas. J’étais seul et j’étais orphelin.
Aucun adulte n’avait eu le courage ou su trouver les mots pour m’expliquer la chose, pas même mon père, reparti vers Paris reprendre le travail, sans rien me dire. Je me souviens des nuits de pleurs, consolé par mon beau-frère et d’autres fois par le chien. La mort sera toute ma vie durant une compagne constante et les chiens mes amis. Les chiens, il y en a pour tout, pour la chasse, pour garder les vaches, pour garder les maisons et pour consoler les orphelins.
A propos de la mort de ma mère, j’ai toujours en mémoire le récit de Bambi, mon livre illustré. Le faon nommé Bambi coule des jours heureux. Mais un jour qu’il s’aventure en terrain découvert avec sa mère, un coup de feu claque et des chasseurs les séparent à tout jamais. J’imagine et entends le coup de feu, sec, puissant et définitif. C’en est fini de la mère. Ce fût le silence, un silence de néant. Dès lors, Bambi ne peut plus apprendre à survivre qu’auprès de son père ou seul. Je n’avais pas mal, c’était au delà de la douleur. La mère n’était plus et le petit garçon était seul avec un immense trou dans le cœur. Sans doute est-ce à ce moment que lui vint ce goût infini pour les autres et ce désir d’être aimé dans une quête insensée et quelques fois désordonnée.
Je n’ai pas eu droit comme dans le dessin animé aux paroles du Prince de la forêt, le père : « ta mère ne sera plus jamais à tes côtés » suivies d’un silence puis « viens », nouveau silence et « mon fils, viens ».
Mon père était reparti, j’étais seul et à six ans j’étais orphelin. Les gens du village lorsqu’ils parlaient de moi disaient « le petit parisien orphelin » et les enfants moins compatissants « parisien tête de chien, parigot tête de veau » Pour les jeunes enfants le malheur des autres n’est pas très accessible. C’est ainsi que naquirent chez moi défiance, agressivité et relation à la mort. Je pense à la mort quotidiennement c’est quelque chose qui est là, prégnant, et qui par contre coup donne sa puissance à ma vie. Cette manière d’être me permet de penser à chaque instant à la vie extraordinaire que je me suis faite et dont je suis l’artiste conscient.
Marguerite Yourcenard a dit, au sujet de la mort, qu’elle regrettera Hadrien, personnage de ses romans et peut-être les jacinthes du Mont Noir ou les violettes du Connecticut au printemps. Ce que je regretterai de cette époque ce sera, avec ma mère au printemps et à l’été 54, la campagne en fleurs, les poussières qui volent dans les rayons de soleil à travers les volets clos au moment de la sieste. Ce sera aussi les chemins bordés de lucioles, les hirondelles qui rasent la route non goudronnée soulevant un léger nuage de poussière à chaque passage. Mais il restera aussi malgré tout l’image d’un petit garçon seul par une triste journée d’hiver avec un grand trou au fond du cœur que rien n’a pu combler.
Paizay le Tort
A la campagne c’est d’abord la nature qui nous enseigne la vie. Cette période de mon existence a été un moment intense d’apprentissage. Pour une bande de gamins plus ou moins livrée à elle-même chaque jour est un jour de découverte. En conduisant la chèvre au bouc on apprend la reproduction. En se baignant nu dans la rivière on découvre les corps des unes et des autres. On joue au docteur et on s’examine. On joue au papa et à la maman, on découvre des émotions. On avale un peu n’importe quoi, on découvre le transit en observant les déjections. On joue avec les insectes ou avec les plantes, on découvre leur vie. On peut passer plusieurs minutes à gratter un trou dans la terre pour faire sortir un grillon. On peut atteler un scarabée et en faire une machine à tirer des cailloux. Il y a tant des choses à découvrir, même si on n’en connait pas les noms on peut attribuer des rôles aux différentes formes de vie. Les grillons, les scarabées, les sauterelles sont autant de jouets entre nos mains enfantines. Il n’y a pas de cruauté abusive mais seulement une indifférence à la mort. On connait le rôle d’un furet pour la chasse au lapin. On sait que le petit du hérisson n’a pas de piquants mais beaucoup de puces.
Après la mort de ma mère, je vais vivre pendant quatre années en pension chez ma demi-sœur Mauricette et sa belle famille, les Crossin. Nous habitions à côté des grands-parents Crossin. Gaby la grand-mère, une femme plutôt corpulente ce qui sied aux grand-mères, était très gentille. Elle me considéra toujours à égalité avec ses petits-enfants. J’ai pris quelques fois de ses nouvelles et j’ai quelques lettres d’elle. Elle habitait un bâtiment contigu à celui où étaient installés en location Mauricette, Roger et leurs cinq enfants, mes neveux et nièces. La grand-mère Gaby avait hérité de sa maison et c’est elle qui avait fait venir là Mauricette et Roger. En même temps que la maison elle avait hérité du garçon de ferme, Lucien. Il logeait dans une dépendance en bout de bâtiment dans des conditions qui seraient inacceptables aujourd’hui mais qui étaient normales dans les années 50. L’important c’était de ne pas le mettre à la porte. Une paillasse valait mieux que rien du tout. Il avait un abri, travaillait comme journalier chez les paysans du coin et avait des relations humaines. Bien des contemporains laissés sur nos trottoirs en rêveraient dans ce monde moderne aseptisé mais déshumanisé.
Le mari de Gaby, Roger Crossin père, était un homme remarquable mais avec lequel j’ai eu peu de rapports. A cette époque les enfants étaient sous l’aile des femmes et les hommes ne s’en occupaient guère. Le grand-père Roger était un grand buveur et aussi un acrobate. Lorsqu’il était à jeun il faisait des équilibres sur les mains ou debout sur son vélo, il avait pour cela toute notre admiration d’enfants. Une anecdote me revient le concernant. Un jour son fils Roger, mon beau-frère, l’avait emmené sur le tansad de sa moto, une 125 Peugeot modèle 55. Le tansad désigne le siège supplémentaire d’une motocyclette, situé derrière celui du conducteur, il s’agit donc du siège du passager. On le fixait par vis et on pouvait l’enlever facilement. Roger n’avait pas dû viser les boulons comme il faut. Toujours est-il qu’il a perdu son père en route et ne s’en est aperçu qu’à l’arrivée. Le grand-père a continué à pied jusqu’à ce qu’on vienne le chercher. Un bon petit de coup de rouge à l’arrivée et ça repart.
Les Crossin étaient des gens curieux. L’un des enfants, Paul, avait fait la légion étrangère. Il habitait avec sa femme Léone et leurs enfants au Vignolet à quatre kilomètres de la Grelière. De son engagement et de son voyage en Algérie, il avait rapporté un goût certain pour la fabrication de tapis et pour le canevas. Il dessinait ou faisait dessiner par son frère Roger des motifs de type arabisant et passait ensuite les fils de couleur. Léone était une femme de bonne allure assez grande. Ils avaient plusieurs enfants plus jeunes que moi dont j’ai oublié les prénoms. Nous faisions de fréquentes visites au Vignolet où nous avions l’occasion de voir de magnifiques oiseaux dont un majestueux paon dans une propriété voisine.
Roger, mon beau-frère était un prodige. Il reproduisait n’importe quelle image avec une grande exactitude ; une photo ou une carte postale devenait ainsi un tableau. Il dessinait des deux mains et pouvait même faire un dessin correct avec le crayon dans la bouche ou entre les doigts de son pied. Antony et Monique, les derniers enfants de la grand-mère Gaby n’avaient pas de talents particuliers mais je les ai peu vus car ils n’habitaient pas sur place.
Dans le clan des enfants, il y avait surtout mes neveux et nièces. La plus âgée Irène était d’un an mon ainée. Elle avait une longue chevelure brune qui descendait jusqu’aux fesses et une aversion totale pour les pois cassés qu’on nous servait une fois par semaine. Pour la coiffure j’étais celui qui s’en occupait pour lui éviter un brossage trop rapide et donc très douloureux. C’est ainsi que j’ai appris à faire les tresses. C’est également moi qui avalais une double ration de pois cassés pour limiter son envie de vomir. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il fallait avaler ce qu’on nous servait. Pour ma part je détestais la morue surtout lorsqu’elle était mal dessalée. J’étais aussi celui qui accompagnait Irène à la fontaine pour aller chercher l’eau. De nuit, lorsque le soleil se couche tôt, elle était effrayée et pleurait s’il fallait y aller seule. Nous n’avions pas l’eau courante et la fontaine se trouvait à l’orée du bois. Plus tard c’est sans doute cela qui me rendra particulièrement sensible à la scène des Misérables quand Jean Valjean vient chercher Cosette et qu’il prend le seau d’eau bien trop lourd pour la fillette de neuf ans.
Son cadet, Roger troisième du nom, que tout le monde appelait Gégé, était réputé être le chouchou. C’était sans doute lié à ses ennuis de nourrisson, il avait été opéré des deux jambes. Les autres enfants, pour se venger, de temps en temps l’appelaient « pattes de laine ». Son problème aurait eu, selon mes souvenirs, pour origine la syphilis que Roger, son père, avait transmis à ma sœur. Cette maladie était fréquente dans les milieux populaires jusqu’à sa quasi disparition à la fin du XXème siècle. La syphilis est une infection sexuellement transmissible contagieuse. De fait, Gégé sera toujours un enfant à part peu lié aux autres.
José était le plus petit en âge de galoper, il suivait les grands et complétait la bande. Les petits derniers, Patricia et Tony, étaient des bébés. Notre petit groupe était renforcé pendant l’été par la venue des cousins de Nantes pour constituer les sauvageons de la Grelière.
Notre vie quotidienne
S’occuper de six enfants ça ne peut fonctionner que si chacun met la main à la pâte. En dehors de nos heures de classe nous avions des tâches variées. Nous devions ramasser de l’herbe pour les lapins. Il nous fallait aussi préparer la nourriture des canards à base d’orties coupées dans de l’eau. Bien sûr il y avait les chèvres à sortir et l’eau à quérir à la fontaine. Lorsque c’était la saison nous ramassions les pommes de terre. Enfin nous allions discrètement chercher du bois dans les futaies voisines, c’est à dire que nous y allions de préférence à la nuit tombante pour ne pas être vu par les paysans. A la bonne saison, nous allions à la recherche de mâche sauvage pour les humains. Quand on est pauvre tout ce qui se mange est intéressant. Je me souviens avoir mangé du hérisson, une idée de Roger, de l’anguille braconnée à l’aide de lignes de fond, posées dans la rivière, et qu’il fallait relever discrètement pour ne pas être surpris par le garde pêche. Roger avait aussi un fusil et une chienne de chasse, Diane, ce qui permettait de déguster de temps en temps du lapin de garenne. L’hiver Roger tendait des pièges pour les merles. Un piège à rat et un morceau de pomme faisaient l’affaire. Bien des petits oiseaux tout aussi affamés se firent prendre sans profit pour nous. Roger n’avait pas de métier, à l’occasion il travaillait comme maçon.
Nous vivions à La Grelière, un site familial autosuffisant. Pierre Rabhi appellerait cela aujourd’hui « oasis intergénérationnelle », c’était seulement une famille vivant sur un petit héritage.
L’école
C’était le bon vieux temps pour certains. C’était surtout celui de l’école de la sélection et du dressage républicain. Dans la classe nous étions une trentaine, le maitre ou la maîtresse était respecté et surtout craint, les châtiments corporels étant acceptés par la société. On allait à l’école cinq jours par semaine samedi inclus. Le jeudi était réservé à l’apprentissage de la catéchèse. Le catéchisme était pour nous l’occasion de bagarres avec les autres enfants qui nous voyaient comme des étrangers. Le dimanche nous allions à la messe. Le prêche du curé était sommaire. Je me souviens d’une fois où il a fait reproche aux jeunes paysannes de mal tenir leurs bêtes qui avaient gêné sa voiture. La quête était un moment qui disait l’archaïsme du territoire, dans le panier on pouvait voir le billet de banque de « Môssieur le Maire » et un plus gros de « Môssieur le Marquis ou Comte », je ne sais plus.
En milieu rural une même classe comprenait plusieurs niveaux. L’école d’autrefois n’avait que pour objectif d’apprendre des rudiments de lecture, d’écriture et de mathématiques à un public qui en majorité n’était pas là pour atteindre le collège ni le lycée. Il y avait d’ailleurs un examen d’entrée en sixième, une sélection terrible. La grande masse des écoliers avait vocation à intégrer les usines ou aller aux champs à la fin de la scolarité obligatoire, c’est à dire à quatorze ans. En classe la pédagogie était frontale et magistrale. Celui qui suivait était récompensé, l’élève en difficulté prié de se tenir à carreau et les indisciplinés subissaient des châtiments corporels acceptés par la société.
Il y aura toujours un paquet de rigolos qui affirmeront que le niveau était meilleur qu’aujourd’hui, c’est faux. Aujourd’hui la plupart des enfants savent lire en fin de CP comme il y a soixante dix ans. Observez autour de vous les seniors. Sont-ils plus érudits que les jeunes ? Non. Beaucoup souffrent d’illettrisme et d’un manque de culture générale, surtout dans les milieux populaires où l’ouvrier commençait à trimer dès quatorze ans faute de possibilités d’études. Je ne m’étendrai pas « l’illectronisme », néologisme associant illettrisme et électronique, qui est de plus en plus courant pour décrire ce qui est perçu comme un déficit de compétences dans l’utilisation des TIC. Une enquête en France conclut que 23% des Français ne sont pas à l’aise avec le numérique. Selon le Baromètre du numérique 2018, 36% des sondés déclarent être très inquiets ou assez inquiets à l’idée d’accomplir des démarches administratives en ligne. Ces personnes sont souvent plus âgées et moins diplômées que la moyenne de la population. Les personnes seules, les femmes, les ouvriers, les personnes au foyer et les personnes à bas revenus sont surreprésentées parmi les sondés.
A Paizay le Tort l’école des petits regroupait le cours préparatoire, les cours élémentaires première et deuxième année. L’école comprenait deux salles de classe dont une seule était occupée. L’autre était l’arrière classe où s’entassaient les tables et bancs ne servant pas et plein d’autres choses inutiles mais qui pourraient servir, sait-on jamais. Le bâtiment abritait aussi le logement de fonction de l’institutrice, Madame H. Madame H était une institutrice à l’ancienne. C’était une femme mal aimable sauf avec les enfants de paysans lorsque leurs parents avaient tué le cochon et que l’institutrice recevait sa part. Nous n’avions pas les moyens d’avoir un cochon donc nous avions peu d’amabilités. Elle était très sévère surtout avec les petits sauvageons de la Grelière. Il faut bien reconnaître qu’ils n’étaient pas très studieux et un peu dévergondés. Elle nous passait sur les jambes des poignées d’orties pour nous rappeler les bonnes manières. N’étant pas très dissipé car j’aimais apprendre je n’avais pas souvent à me gratter. Les autres punitions étaient d’être relégué dans l’arrière classe ou dans la cave et de voir partir les autres avant nous en fin de journée. Nous étions aussi quelques fois condamnés aux « travaux forcés » comme arracher les mauvaises herbes dans le jardin de la maîtresse, sous surveillance de son mari.
Pour la cave j’ai eu une fois une idée de vengeance que j’ai mise à exécution. J’ai prélevé un peu de vin dans une bouteille mal bouchée et j’ai complété avec mon urine. Je ne sais pas si cela à nuit au goût mais cela m’a bien vengé ce jour là. La deuxième école était pour les cours moyens et la classe du « certif », l’instituteur était un jeune enseignant, Monsieur P. Avec lui c’était le grand changement. Nous avions des activités variées et créatives. Nous avons construit une maquette de ville toute en bois peint. Nous avons aussi découvert le sport. A se sujet, un jour il nous a demandé d’apporter un short. Sans doute un peu ailleurs, j’ai enregistré « un chat ». En arrivant à la maison et en relatant la demande cela a beaucoup surpris ma sœur qui se demandait qu’est-ce qu’on pouvait bien faire avec un chat en sport. Les autres ont rectifié ce qui a bien fait rire tout le monde. Cet instituteur sera, avec d’autres plus tard, un éveilleur d’esprit pour moi et me permettra de garder entiers ma curiosité et le goût d’apprendre. Nous avions environ trois kilomètres à faire pour venir à l’école aussi nous apportions avec nous notre casse croute pour le midi ainsi que notre boisson. Pour certains enfants la boisson pouvait être du vin coupé avec de l’eau, c’était autorisé. Avec pour préoccupation principale la santé des générations futures, Pierre Mendès-France remplaça le 1er janvier 1955 le vin coupé dans les cantines scolaires par la distribution gratuite de lait sucré aux écoliers.
Les sauvageons de la Grelière
L’été nous pouvions être dix ou douze suivant les visites des petits nantais du quartier du Grand-Blottereau, des cousins de la famille Crossin. Le Grand-Blottereau est un quartier de Nantes qui a abrité successivement, des cantonnements militaires, des baraquements pour les familles délogées par les bombardements puis des rapatriés d’Algérie ou encore quelques bannis en cité d’urgence. En plus de ma nièce et de mes neveux, Irène, Roger, José, Patricia et Tony, il y avait ces cousins. Leurs prénoms m’échappent mais pas tous. Je me souviens bien de Lionel le plus âgé, de Nicole la sourde et muette, de Dominique mon amoureuse. Notre vie était un florilège d’actes d’insouciance enfantine que les adultes appelaient nos bêtises. A cet égard, la campagne offrait une palette infinie pour les jeunes artistes du théâtre des bêtises. Grimper aux arbres, dénicher les oiseaux, chaparder des fruits, se baigner dans la « Berlande », y pêcher des vairons était notre théâtre.
La Berlande est une petite rivière du pays Mellois. Elle prend sa source au sud de Saint Génard et reçoit la Légère avant de se jeter dans la Boutonne qui alimente, elle même, la Charente. La rivière c’était aussi l’accident de la chute dans l’eau, pas très grave le plus souvent, mais embarrassant lorsqu’on rentre mouillé à la maison.
Aux armes, citoyens! Lance-pierres et arcs étaient pour nous un équipement de base. Les lance-pierres ou « lance-pigot », en argot de « mouflet ». Le « lance pigot » était l’arme idéale pour faire la guerre aux godets électriques qu’on appelait aussi des « tasses ». C’était aussi l’arme pour « dégommer » tout et rien et quelques fois des oiseaux. L’arc était plus noble, il servait à faire « la petite guerre ». Il fut aussi essayé par moi sur un coq de la ferme voisine. Le malheureux y a laissé la vie par un tir en pleine tête. Plus de trente ans plus tard, la vieille fermière saura me le reprocher lors d’un passage à Paizay le Tort en 1988. Le pistolet à bouchons était un privilège, il permit à mon neveu Gégé de faire un trou dans mon short et une brûlure à ma fesse. Le tir à bout portant devrait être interdit, voilà ce que je dis.
Certains étés nous partions camper. Un vieux drap et quelques branches, voilà la tente idéale. Se cacher entre gamins voilà une bonne idée ; personne ne nous voit. La virée ne nous éloignait pas de plus de un à deux kilomètres. Le bambou nous fournissait des cannes à pêche et d’excellentes perches à sauter ; à condition de ne pas s’ouvrir la main sur une écharde qui dépasse, ça s’est vu. L’imprudence de l’un d’entre nous lui laissa la main ouverte sur toute la largeur, confiscation des perches et punition générale, c’était la règle. Dans un collectif chacun est responsable des autres, surtout les plus âgés.
La Grelière se trouve en val, elle est dominée par des coteaux assez pentus. C’était une source de jeux inépuisable. Notre planche à roulettes était faite d’une planche entre les quatre roues d‘une vieille voiture d’enfant, notre « biclou » était un vieux vélo sans pneu ni chambre à air que nous avions trouvé dans la décharge. Pour descendre le coteau ça ne faisait pas de différence. Merveilles de l’enfance! La maîtrise imparfaite de l’usage du vélo d’adulte, la jambe passée sous le cadre, nous vaudra quelques chutes sans gravité.
Plus grave sera le renversement d’une charrette chargée d’enfants. Cette fois c’est le manque d’attention des adultes qui nous mis en danger. C’était l’été, le soleil brillait sur la Grelière. Une charrette à cheval était venue, sans doute pour amener du bois ou autre chose. Il y avait là une petite foule d’enfants, les uns résidant à l’année, les autres en vacances. Un tour de charrette c’est comme un tour de manège, allez, tous dedans! Le cheval broutait en attendant son chargement et avant d’attaquer la pente du coteau. Le chemin est d’abord faiblement pentu puis dans le virage la pente augmente, le cheval est mal harnaché, il s’arrête puis il recule. Rien n’y fait, les cris du charretier ne le font plus avancer, pris au cou il recule, recule et voilà la charrette « cul par dessus tête » et les enfants dedans. Il n’y aura aucun blessé, pas une égratignure, mais une très grosse peur, surtout pour les adultes. Comme on le voit, l’apprentissage du coteau peut se révéler compliqué.
Au pied du coteau funeste il y avait un cerisier. C’était le mois de mai, les cerises sont rouges et délicieuses, comme plus tard les lèvres des adolescentes sur lesquelles on vole un baiser. Pour l’heure à six ans je suis loin de cela, la question c’est : où mettre ces cerises que je cueille avec avidité ? Dans ma culotte bouffante ça ira. Bonjour les fourmis et trop tard pour les regrets, ça courre partout les petites bêtes.
Sur l’autre coteau, après le petit bois, la chèvre broutait attachée à un pieu. Je devais la surveiller. Plus tard, alors que je revenais d’une exploration ou d’une aventure, la chèvre avait glissé et s’était pendue. C’est bête une chèvre. J’ai eu droit à la fessée. Mais il ne faut pas perdre la viande. Comment faire sans réfrigérateur et sans glace ? Roger eu une idée. Il a dépouillé et dépecé la bête, puis il a mis les bouts de viande dans une jarre avec du sel pour les conserver. Il est malin mon beau-frère. C’est seulement dans les jours et semaines qui suivront que je reviendrai sur cet avis positif ; ce n’est pas bon du tout la chèvre salée. J’ai bien regretté de ne pas l’avoir mieux surveillée.
J’ai toujours été assez gourmand et le fromage blanc, j’aime bien. On allait le chercher à une ferme sur la route du village. En revenant j’avais trouvé le moyen de me récompenser. Je passais le doigt autour du fromage frais. Il n’y avait pas de trace de mon forfait. Bien sûr ma sœur se plaignait en disant que les fromages étaient de plus en plus petits. J’ai rapidement cessé le truc par peur d’être découvert. J’aime toujours le fromage frais. Nous allions également chercher le lait de vaches directement à la traite. Ensuite il fallait le faire bouillir pour tuer les germes. Pour les œufs le meilleur moment était celui de la Chandeleur. Selon la tradition nous allions, grimés, de fermes en ferme en disant « coco, coco ». Nous avions droit au don de quelques œufs qui permettaient de faire d’excellentes crêpes. Les crêpes étaient avec la bouillie de farine blanche ce que nous aimions le plus. Par ailleurs la base de notre alimentation était la pomme de terre, râpée en soupe, écrasée en purée, avec ou sans accompagnement ou les pois cassés. Pour l’accompagnement ça dépendait, lapins d’élevage ou au collet quand ils n’avaient pas la myxomatose, anguilles de braconnage, merles au menu d’hiver, morue salée, plus tout ce que nous pouvions trouver suivant la saison et nos moyens financiers.
Les noëls à la Grelière ont été des sources de problèmes pour moi car ils mettaient en évidence le manque pour mes neveux et nièces. Mon père s’efforçait de m’envoyer des cadeaux aussi beaux que possible. Je me souviens d’un tank à ressort qu’on remonte avec une clé et qui pouvait gravir les pentes. Les autres n’avaient pas ce genre de cadeau que je partageais avec eux et que nous complétions avec des bobines de fil en bois et un élastique pour moteur. Ma sœur ne voyait pas toujours les choses ainsi. Un jouet ça se partage, pas la brosse à dents jointe au tank. Elle me la confisqua par souci d’égalité. J’ai vécu cela comme une injustice et je me suis mis en tête de vaincre l’injustice et de récupérer ma brosse à dents rangée dans le haut du buffet. Hélas c’est tout le haut du buffet qui m’est tombé dessus. L’injustice a persisté avec en prime une bonne fessée. C’est sans aucun doute en ce temps là que je pris l’habitude de ne pas me laver régulièrement les dents.
Comme toujours il y avait des moments de rêve. Passé décembre, le soleil et la neige sont sur la campagne et dans la cheminée un bon feu apporte beauté et tranquillité. L’après-midi nous allons relever les pièges qui nous fournissent un peu de viande. Quelques merles sont pris dans les pièges mais aussi des petits oiseaux qui cherchaient leur nourriture ; trop petits, ils ne nous nourrirons pas. Mais qu’importe tout cela, la campagne est si belle sous la neige. Tout peut devenir une distraction, nous sommes en campagne et le réseau électrique, en 110 volts, n’était pas très fiable, les soirs de tempête il y avait de nombreuses coupures. Autour de la cheminée avec grand-mère Gaby, nous écoutions quelques chansons pour faire patienter puis nous comptions jusqu’à ce que le courant revienne, un, deux, trois…En attendant, on dégustait quelques pommes mûries dans le grenier et un peu blettes, un délice.
Dans le courant de 1956 mon père s’était mis en ménage avec Eliane, l’ex-femme de son neveu André. Il m’a fait venir à Paris pendant les vacances. Nous habitions une chambre meublée 117 avenue Jean-Jaurès. Mon père travaillait de nuit aux abattoirs de la Villette dans le 19ème arrondissement. Cela n’a pas duré longtemps. Éliane qui avait elle-même trois enfants placés n’a pas souhaité s’occuper d’un autre enfant. La séparation a été rapide. Comme il n’y avait personne pour être avec moi, je me souviens être allé coucher avec mon père sur son lieu de travail. Il avait une cabine avec un lit et un petit équipement pour chauffer sa nourriture, son rôle était de contrôler du point de vue sanitaire les camions qui rentraient et sortaient la nuit. Après ce court intermède j’ai regagné Paizay le Tort. Plus tard mon père perdra sa place aux abattoirs parce que son casier judiciaire n’était pas vierge. Il demandera une réhabilitation qu’il obtiendra mais ce sera trop tard.
Les distractions locales
Ma première découverte du cinéma avait eu lieu à Paris avenue Jean Jaurès, le film joué était Guillaume Tell avec en première partie un dessin animé qui devait être rigolo puisque mon rire aux éclats m’a valu, à l’entracte, une sucette glacée gratuite de la part du gérant. En ce temps là il n’y avait pratiquement pas de téléviseurs, juste la radio. A Paizay le Tort, au village, un cinéma ambulant venait s’installer au café. On déplaçait les chaises et les bancs, un drap servait d’écran. Le café était à deux ou trois kilomètres de la maison, y aller était pourtant un moment de grand plaisir. Je me souviens précisément de deux films : « Si tous les gars du monde » et « Le Titanic ». Peut-être que nous n’y sommes allés que deux fois durant mon séjour. Dans la nuit inondée de lucioles et sur le chemin bordé de vers luisants, nous chantions « Nini peau de chien ». Les lucioles étaient abondantes à la campagne avant que les pesticides et autres saletés n’envahissent notre quotidien. C’était féérique entre le ciel et ses milliards d’étoiles et les lucioles et vers luisants qui semblaient leur répondre. C’est un souvenir inoubliable où je flottais entre la peur de la nuit pour l’enfant et le réconfort de la chanson des adultes qui chasse les mauvais esprits. Je découvrais sans le savoir le début de la « culture de masses » au travers du cinéma comme l’exprimera en 1962 Edgard Morin.
Aujourd’hui, les séries ouvrent les jeunes esprits à un nouveau monde, mais nous sommes souvent loin de l’humanité des films vus sur un drap en guise d’écran dans les années 50. La tablette remplace le ciel étoilé et les lucioles mais ne fait pas autant rêver.
Chaque année il y avait la balade au bord de la Berlande. C’était la fête du village. Quelques stands et marchands occupaient le pré. On mangeait, on buvait et on s’amusait. C’est là que Gégé me fusilla avec son pistolet à bouchon. Il y avait aussi une fête au château de Melzéart. Un épisode particulièrement affreux m’a marqué. Dans les carnavals et autres fêtes anciennes, il était de bon ton de se lancer des confettis et même de saisir quelqu’un par derrière et de lui en remplir la bouche. Au cas particulier, cela tourna mal car les confettis s’étaient agglutinés dans la gorge et le malheureux s’en est étouffé. La fête au château s’est mal terminée.
La vie à la Grelière suivait son cours, j’étais à peu près apaisé car les enfants oublient vite, du moins superficiellement. Seules quelques dates dans l’année ravivaient ma douleur. La fête des mères était pour moi un de ces moments, 1955 fut la première fête sans mère à souhaiter. Pour faire comme les autres j’avais fait un dessin à l’école. Mais lorsque je l’ai donné à Mauricette, elle m’a dit « je ne suis pas ta mère ». Cette vérité fût néanmoins une blessure. Noël était aussi un mauvais moment, car outre qu’on approchait du mois de janvier, sans mère ni père présents cette fête perdait son caractère magique.
Mais bientôt j’allais quitter ma famille d’accueil pour une vraie famille, avec un père et une mère. Là où je vais aller, les autres enfants ne sauront même pas que j’ai été orphelin. Vers le 15 décembre 1958 mon père est arrivé pour venir me chercher. Le jour du départ était fixé au 17 décembre au soir. Le moment venu, l’atmosphère était tendue. Il fallait partir sinon on allait manquer le car de Melle à Niort. Ma sœur faisait durer les choses, elle savait qu’on allait se quitter pour longtemps. Rien n’était prêt, elle n’avait pas envie que je parte. Moi à mi-chemin entre regret et espoir j’attendais de mettre ma main de bambin dans la grosse main rassurante de mon père. Nous allions partir tous les deux, enfin ! Toutes ces nuits de larmes et de solitude pour qu’enfin je parte avec lui et que je laisse là mon plus grand malheur. J’allais dire au revoir à la grand-mère Gaby. Mère, père, grand-mère, grand-père, tous ces termes sont rassurants et merveilleux pour un enfant. Sans ceux-là un enfant est enfermé dans une prison de sensibilité sans secours. A cette date je ne connaissais pas encore mes grands-parents, je n’avais comme tante que le souvenir de tata « dingue-dingue », pas de fratrie de mon âge. Même ma sœur était seulement une « demi-sœur ». Qui étais-je ?
On part, on est en retard, Melle est à cinq kilomètres. A la sortie du village, Roger mon beau-frère met son vélo en travers de la route pour arrêter une voiture dont le chauffeur accepte de nous prendre, mon père et moi. Ouf ! On va être à l’heure. Je rayonne de joie. Enfin après quatre ans à Paizay le Tort je vais pouvoir vivre avec mon père. Ma sœur, mes neveux tous ceux que je laisse, je ne m’en soucie pas. Ingratitude de l’enfance ? Non ! Seulement j’ai assez souffert et je ne pense qu’au bonheur de retrouver mon père et une famille à moi. Plus tard, encore aujourd’hui, je regrette de ne pas l’avoir serrée plus fort dans mes bras Mauricette, ma « sœur-mère ».
L’adolescence
J’entrais dans ma onzième année et dans l’adolescence qui est la période de la vie marquée par d’importants changements biologiques et psychosociaux. C’est au cours de cette étape que les jeunes commencent à construire leur identité d’adulte. Ils développent des compétences de communication, de contrôle émotionnel, de résilience. Ils renforcent aussi leur propre vision de l’éthique et de la morale. C’est aussi le début de la formation de liens d’amitié forte avec les autres, et à son tour, le début de l’attraction pour le sexe opposé. Ce qui émerge, c’est le plaisir de la découverte, de la liberté, de nouvelles manières de penser, de nouvelles émotions, et donc de nouveaux liens, ce qui n’est pas sans provoquer tout un remue-ménage intérieur. Si l’adolescence est un moment de croissance et de potentiel exceptionnel, c’est également un moment où les risques sont importants et au cours duquel le contexte social peut exercer une influence déterminante. Avec l’adolescence vient aussi l’apprentissage de la douleur. Le sentiment d’injustice perçu dès l’enfance se transforme d’abord en révolte puis plus tard en conscience politique et sociale. Mon adolescence allait être plutôt perturbée par le mode de vie familial.
Le retour
Niort le 17 décembre 1958 au soir, nous sommes dans la chambre d’hôtel, c’est beau, c’est moderne. Je découvre le va et vient, clic-clac, j’allume à la porte et j’éteins à la tête de lit et vice versa. Je teste cela une partie de la soirée. Je m’amuse bien et papa est patient. Comment dormir, je suis avec lui, la vie est merveilleuse. Dis papa pourquoi toutes ces miroirs ? Est-ce que je peux essayer mes nouveaux vêtements ? Comment il est le camion qui nous emmènera demain ? Mais il est plus fort que toi, petit garçon, le sommeil qui t’impose enfin le silence. Est-ce un rêve ? Non le matin nous sommes toujours là tous les deux. Il me réveille, nous allons déjeuner puis nous partons. Longtemps encore j’aurais cette impression d’être dans un rêve. Qui ne l’a pas éprouvée ne peut pas comprendre, c’est très étrange. C’est différent des rêves qu’on fait en dormant. Croire son rêve réalité ou sa réalité un rêve ce n’est pas la même sensation. Il y a le corps présent dans le deuxième cas.
Le camion est au rendez-vous et le chauffeur est gentil, je crois qu’il m’aime bien tout de suite. De Niort à Tours, papa me parle un peu de ma nouvelle mère. Il me dit qu’elle est gentille. Elle s’est occupée d’aller chercher au Secours catholique de nouveaux habits pour que je sois bien habillé à mon retour. Je ne sais pas ce qu’est le Secours catholique, peut-être un magasin. Avant de partir j’avais juré à ma nièce que je ne l’appellerai pas maman, la nouvelle femme de mon père, mais je sais déjà que je ne tiendrai pas parole. Je ne peux que l’aimer celle qui par son mariage me permet d’être avec lui, d’exister à nouveau, de ne plus être l’orphelin. Je sais qu’à l’école au moment de la fête des mères je pourrai écrire un poème pour une nouvelle maman et que je vivrai normalement.
Tours 18 décembre 1958, nous arrivons, le chauffeur nous laisse boulevard Thiers avant d’aller au garage des Transports Laurent rue Giraudeau, c’est la fin du voyage. C’est étrange les coïncidences de date car le même jour naît Brigitte Horn qui plus tard deviendra la filleule de mes parents et prendra la place principale dans le cœur de ma belle-mère. Nous cheminons dans les rues qui nous conduisent vers le 38 de la rue Jean Macé. Je vais à la découverte de ma nouvelle vie. C’est un rêve exquis avant une suite de mauvais réveils et de mauvais jours. A mon enfance en pointillé succèdera une adolescence morcelée.
Ma nouvelle famille
Mon père était revenu à Tours au début de l’année 1958 pour se rapprocher de sa famille. Il logeait chez ses parents rue Georges Courteline. Son dernier emploi à Paris, dans l’entreprise Auer fabriquant de chauffage, s’était terminé le 20 février 1958. A trente neuf ans c’était un bel homme, séduisant et veuf. Pour se distraire il trainait dans les bars où il cherchait de la compagnie. C’est dans un café place de la Résistance au printemps 1958 qu’il rencontre celle qui allait devenir ma belle-mère, Jeanne Levent connue par son deuxième prénom, Catherine. Catherine et Mireille sa sœur de cœur ont fait le voyage de Nantes à Tours au hasard. Elles s’étaient cachées sous la bâche d’un camion. Le camion les a emmenées à Tours. Pourquoi Tours ? Je pense que la réponse, pour ces deux femmes en recherche d’aventure, était pourquoi pas Tours. Les trois convives ont sympathisé et passé un moment ensemble. Armand et Catherine, en particulier, se sont plus. Les deux femmes n’avaient pas de point de chute à Tours, le besoin a sans doute forcé le destin. Le hasard et les besoins sont souvent les maîtres du jeu ; sans ce hasard là, mon récit de vie serait différent. Catherine et Mireille avaient besoin de se loger, pour leur premier soir ce sera un hôtel rue de la Scellerie, à proximité du théâtre. Ils se plaisaient à se remémorer leur aventure car la chambre était prévue pour deux personnes alors qu’ils étaient trois. Ils ont joué à cache-cache avec l’hôtelier. Je ne sais pas exactement comment s’est construite la suite. Je crois qu’elles sont reparties et mon père a fait le voyage de Nantes pour revoir celle dont il était tombé amoureux. Après la cueillette des haricots à Allonnes en Maine et Loire à l’été 58, ils se marieront le 25 août de la même année. Le temps de s’installer et la décision était prise de me faire venir avec eux.
Le 38 de la rue Jean Macé
Je ne sais pas comment ils ont trouvé ce logement. Ils ont probablement cherché un logement dans le quartier Lamartine où résidaient mes grands-parents, mon oncle, ma tante et mon cousin André. Les premiers jours, j’y croyais à peine, j’étais là avec mon père et une nouvelle maman. Le quartier Lamartine jouxte le quartier du Vieux Tours, son axe principal est la rue Georges Courteline qui fait partie de la « Grande Rue ». A y regarder de près je suis lié à cette « Grande rue ». Mes grands parents, père, oncle, tante et cousins ont vécu dans une bande deux cents mètres de large de la rue Racine à la rue Georges Courteline. Ce sera aussi mon chemin pour aller au lycée Paul Louis Courier depuis la rue Jean Macé. Beaucoup plus tard, en mai 2000, l’achat d’un appartement rue Colbert ne sera peut-être pas un hasard.
Ma nouvelle mère s’occupait de moi avec bienveillance et gentillesse. Les premiers jours puis les quelques semaines ou mois suivants furent doux et magiques. J’allais à l’école Jean Macé en face de chez moi et en fin de journée, nous allions chercher mon père à la sortie de son travail. Il travaillait chez Martet Mercier, une entreprise de plomberie au coin de la rue des Tanneurs et de la rue Marceau. Nous revenions ensemble la main dans la main, mon père tenant son vélo de la main droite et moi au milieu. Nous longions le quai jusqu’au Champ de Mars avant de bifurquer vers la rue Jean Macé. J’étais enfin dans un monde apaisé dans lequel je pouvais m’épanouir.
Cette vie normale ne dura pas longtemps, tout au plus deux ans. La nouvelle maman renoua rapidement avec sa vie précédente quelque peu dissolue et avec des fréquentations douteuses. Après une enfance brisée, j’allais vers une adolescence massacrée. Mon monde de 12 à 16 ans fut celui de la promiscuité, du chaos familial, d’un enfant livré à lui même, d’amitiés empêchées, d’une découverte de la sexualité perturbée, d’une mauvaise image de soi et de difficultés pour le travail scolaire. C’est la découverte et la prise de conscience de la misère sociale (abandon d’enfants, prison, délirium alcoolique…), du monde des bas-fonds et du sordide, mais aussi de la Cour des Miracles et de son humanité. Je viens de là. J’y ai vu bien des absurdités et bien des horreurs mais également des beaucoup de gestes d’amour.
L’amour et l’espoir dont il est porteur permettent de tout surmonter. L’individu n’existe que par l’amour. Sans amour, il n’est pour les autres qu’un être social qui répond à des normes et à des critères de société. Il faut être aimé pour exister et rien n’est jamais vain tant qu’on existe. La vie est là qui vibre en attente d’une nouvelle harmonique, d’un autre possible. Il suffit de se rappeler le sourire de celui ou celle qui reçoit et le bonheur de celui qui donne.
Nous étions sous-locataires chez un vieil homme de plus de 80 ans. Le logement se composait de deux pièces principales, d’une petite cuisine avec un évier en pierre et d’une alcôve où dormaient mes parents. Il y avait une autre pièce à part qui était occupée provisoirement par mon cousin André, sa femme Jeannine et leurs enfants, André fils né en 1957 et Louis né en 1958 qui deviendra mon filleul. Les toilettes étaient dans le jardin, le logement n’était pas encore raccordé au tout à l’égout. Un unique poêle à charbon de type Salamandre chauffait la pièce principale. De part et d’autre, deux grands placard. Nous chargions le poêle avec du coke provenant de l’usine à gaz de Tours que Gaz de France fournissait gracieusement à ses employés et ses retraités dont notre logeur. Le coke était livré par camion et déversé dans la cave par la trappe qui donne sur la rue comme dans chaque particulier tourangeau. On complétait avec des boulets de charbon. Il fallait remonter tout cela dans un seau chaque jour en passant par le couloir voisin. C’était une de mes tâches. En plus du chauffage, j’étais chargé l’été d’aller chercher de la glace à la brasserie St Éloi qui deviendra plus tard la brasserie Webel. Je transportais un demi-pain de glace pour garnir la glacière, douze kilos enveloppé dans un sac de jute sur le porte bagage du vélo. Nous n’avions ni frigo, ni télé au début des années soixante.
Notre logeur passait ses journées au lit. Il ne se levait et ne s’habillait que pour aller toucher sa pension du Gaz de France une fois par mois et pour aller voter au moment des élections. Il est mort en 1964 vers 85 ans. Les derniers temps il ne se levait plus de tout et souvent il s’oubliait dans son lit. La charge du nettoyage incombait à ma belle-mère qui se faisait aider. Une de nos connaissances qui était toujours volontaire pour donner un coup de main contre un « coup de rouge » ou quelques fois un hébergement pour la nuit.
La vie quotidienne
Je dormais dans un lit métallique pliant appelé « lit cage » par ressemblance avec une cage lorsqu’il était plié. Une fois déplié on avait un lit de 90 centimètres de large que j’ai dû souvent partager avec une des nombreuses relations de mes parents de passage et ne sachant pas où aller dormir. La « chambre d’amis » que constituait mon lit cage était même parfois fois occupée dans la durée par des intimes.
J’allais à l’école Jean Macé de l’autre côté de la rue et au début nous vivions une vie normale de famille pour un garçon de mon âge. Mais au bout d’un certain temps les choses changèrent. Lorsque je rentrais de l’école j’étais seul, ma belle-mère était partie en goguette avec ses copines. Elle buvait beaucoup, elle confirmera elle-même son éthylisme auprès des médecins dans les années 90 lorsqu’elle aura de graves problèmes de santé. Elle s’arrangeait pour rentrer avant le retour de mon père. Elle exigeait de moi que je ne dise rien et éventuellement que je mente si des questions m’étaient posées. Ne pas parler était possible, mentir à mon père était exclu. Je ne voulais pas devenir complice d’un mensonge. C’est à partir de ce moment que les choses se sont dégradées entre ma belle-mère et moi, de même qu’elles se sont dégradées entre mes parents. Ma belle-mère m’en voulait de ne pas lui céder, elle se mit à me harceler en se moquant de moi régulièrement. Injures ou moqueries devant les autres, tout y passait. Lorsque mon père prenait ma défense cela se terminait par des cris voir des coups entre eux, alors je me taisais et je supportais y compris les mauvais traitements lorsqu’elle avait bu. Dans les deux années qui suivirent, la situation continua de se dégrader. Mon père suivant le chemin ouvert par sa femme sortait le soir, buvait et travaillait de moins en moins régulièrement. Les fins de mois comme on dit aujourd’hui, en fait les gens étaient payés à la semaine, devenaient de plus en plus difficiles. Une semaine il y avait un peu d’argent, une autre il n’y avait rien. Les secours publics étaient insignifiants, quelques bons de pain et de viande de la mairie et la soupe populaire rue Georges Courteline, là où maintenant il y a le foyer Courteline. Pour avoir du crédit chez les commerçants il fallait être honorablement connu ce qui n’était pas notre cas. Lorsque je faisais les courses je regardais attentivement autour de moi pour ne pas donner les bons en présence de camarades d’école ou d’autres enfants du quartier. Pour aller à la soupe populaire je rasais les murs avec ma laitière à la main. La pauvreté me faisait honte bien que je n’y sois pour rien. La boisson était le problème majeur de mes parents et de leurs fréquentations.
La « Cour des miracles »
Le 38 voyait défiler beaucoup de monde c’était une sorte de passerelle entre le monde normal et la rue. C’était la cour des miracles avec tous les recalés de la vie. Il y avait de tout, vrais amis ou amis d’un soir. En tout cas, des amis il y en avait beaucoup, beaucoup trop même. Certains étaient des habitués, d’autres de passage et de breuvage. La maison était toujours pleine et les soirées se terminaient tard. J’avais souvent du mal à trouver un coin de table pour faire mes devoirs d’école et j’étais toujours très inquiet d’avoir des taches de vin sur mes cahiers. Ce qui aurait été complet en plus des puces de parquet qui parfois sautaient sur ma table de classe. J’étais inquiet aussi car je savais que la soirée pouvait déraper et se terminer en pugilat lorsque toute l’équipée ne sortait pas pour finir au bistrot. Les visiteurs étaient de toute sorte, ceux qui faisaient la route comme ce vieux chiqueur qui avait fait le chemin des Dames et qui racontait la guerre de 14, des libérés de prison, des marginaux telle cette petite femme simplette qui avait un œil bleu et un œil vert (hétérochromie). Elle disait qu’elle avait un œil de sa mère et un de son père. Je peux aussi citer les hommes amenés là par Mireille, Régis un amoureux éconduit qui s’essayera plusieurs fois au suicide, ou encore un nommé Jo sorti de prison qui ne restera pas longtemps mais suffisamment pour me laisser un souvenir marquant. Invité à passer la nuit dans la chambre d’amis, j’ai dû rester éveillé une partie de cette même nuit debout de peur d’être abusé.
Le numéro 38 était un lieu d’accueil, les uns en amenant d’autres, tout le monde était bienvenu. Chacun pouvait y trouver refuge et hébergement le cas échéant. Sous un certain angle c’était un lieu remarquable s’il n’y avait pas eu la boisson et le fait que ce lieu était loin d’être idéal pour un adolescent.
Les voisins étaient très mécontents du tapage et souhaitaient notre départ ce qui justifiera sans aucun doute que la propriétaire refuse de nous louer l’appartement à la mort de notre logeur allant jusqu’à nous priver d’électricité pendant plusieurs mois pendant l’hiver 64/65. Certains soirs, mes parents et leurs convives décidaient de sortir pour finir la soirée dans un de ces cafés ou bouges des rues du vieux Tours, avant sa reconstruction dans les années 70.
Le vieux Tours
A partir de la Loire, il y avait la rue de la Levée, puis la rue des Tanneurs avec ses vieilles maisons et ses entrepôts. Étrange quartier où coexistaient les entrepôts de nouveaux riches d’après guerre et des laissés-pour-compte de la société des trente glorieuses. C’est là que prospérait la famille Veyssière récupérateurs de métaux et autres produits. Les Veyssière ont fait fortune après la guerre en raison de la rareté des métaux et les besoins de la reconstruction. Avant cela la grand-mère ramassait les peaux de lapins dans les campagnes et les os pour faire de la colle. Cela me sera confirmé par Jean-Paul, le créateur du Petit Faucheux, cabaret de jazz à Tours. Il m’a parlé de l’odeur insupportable de la colle en préparation. Les rues entre la rue des Tanneurs et la rue du Grand Marché étaient presque en ruines et on disait que les maisons se déplaçaient portées par les puces de parquet et les punaises de lit. Il y avait là quelques cafés ouverts tard le soir où se retrouvait toute une faune bizarre. C’est là que sortaient mes parents et là qu’ils recrutaient les amis d’un soir ou plus si affinité. Quelques fois quand ils ne m’emmenaient pas avec eux, ils rentraient tard et j’étais seul. Il est même arrivé une fois qu’ils ne rentrent pas du tout ayant trouvé une virée à faire en voiture. La dite voiture de l’ami du moment s’était retrouvée au fossé. J’étais en cinquième au collège et je suis parti le matin sans savoir où ils étaient. Inquiet et furieux d’être sans nouvelles j’avais laissé un simple mot écrit « si vous daignez rentrer je vous informe que je suis parti en classe ». Le mot avait bien porté, ils s’en souviendront longtemps et m’en reparleront plus tard lorsqu’avec l’âge ils se seront calmés comme d’un haut fait de ma part qui montrait bien mon caractère.
Copines, copains et amis des parents
Les complices de fête de ma belle mère avaient pour nom Aimée, Colette, Jeannine la femme de mon cousin André, et Mireille l’amie de toujours.
Aimée était une femme robuste et très brave que j’ai déjà évoquée. Elle avait deux enfants qui lui seront retirés, un garçon blond et tout frisé et une fille très brune elle aussi frisée qui se balançait toute la journée d’avant en arrière. Aimée était originaire de Bretagne, elle même avait des cheveux noirs et frisés. Le père probable des enfants était aussi un breton grand buveur. Plus tard il finira par être condamné pour meurtre suite à une bagarre qui tourna mal avec un de ses compagnons de boisson et de misère.
Colette était une jeune femme, issue d’une famille de gitans sédentarisés à La Riche, elle avait trois enfants, Danielle, Bruno et Brigitte de pères différents. Elle buvait beaucoup et je me rappelle l’avoir vue ivre morte tombée dans le caniveau près de l’église Notre Dame la Riche. Elle tenait par la main ses enfants. Colette mourra d’une cirrhose du foie laissant ses enfants à la charge de la DASS, sauf Brigitte qui sera recueillie par mes parents et deviendra ma sœur en quelque sorte dans cette famille théorique avec des oncles, des tantes et des sœurs qui n’en sont pas vraiment. Il faut sans doute y voir un besoin réel de former communauté.
Mireille, au rendez-vous des habitués, il y avait surtout tante Mireille, Marcelle de son vrai prénom. J’étais son petit complice, lorsqu’elle voulait se faire une soirée de sortie, elle proposait de m’emmener pour lui servir de chaperon. Elle faisait la tournée des bars et intéressait souvent les hommes désœuvrés qui lui payaient à boire en espérant plus. Je récoltais à l’occasion quelques pièces parmi celles qu’on me confiait pour mettre dans le juke-box. Mireille était du genre bohémien, on lui avait retiré ses enfants et elle zonait suivant un axe de Nantes à Tours. A Allonnes dans le Maine et Loire elle faisait la saison de ramassage des haricots verts, tâche qui n’était pas mécanisé dans les années 60. Mireille est décédée d’un cancer de la gorge car elle fumait beaucoup. Elle est enterrée à Saumur où elle avait fini par se poser. Elle séjourna à plusieurs reprises, pendant des périodes plutôt longues à la maison ; ce qui veut dire qu’elle sera souvent ma colocataire dans le lit cage. Je me souviens qu’elle n’avait pas de poitrine et portait des soutien-gorge très rembourrés ce qui me permettait de me moquer d’elle en lui disant « tes seins sont secs sur le fil à linge » lorsqu’elle avait fait sa lessive. Elle m’appréciait beaucoup surtout pour ma discrétion lors de ses sorties nocturnes. C’est elle qui me dira un jour que j’étais « une rose qui pousse sur un tas de fumier ». J’ai retenu cette déclaration, non seulement pour le côté poétique, mais parce qu’elle me semblait une bonne image de ma condition sociale.
Les autres
Margot et Huguette, autres complices vivaient normalement, l’une place Plumereau et l’autre derrière le Botanique. Leurs maris avaient des situations mais il faut croire que cela ne leur suffisait pas, la fête et les copines étaient nécessaires. Jeannine était une très belle femme qui plaisait beaucoup aux hommes et qui n’était pas farouche. Elle et ma belle-mère avaient des connaissances masculines communes avec qui elles traînaient souvent. Certains jours je devais suivre et j’en étais très malheureux pour mon père. Une sortie en voiture à la campagne m’est restée en mémoire, il faisait beau, c’était le printemps et c’était très agréable. Nous étions partis en voiture faire une ballade et j’avais eu droit à quelques sucreries de la part des accompagnateurs. Pour faire plaisir aux mamans on fait risette à l’enfant. C’était culpabilisant, je souffrais de profiter ainsi de ce que je percevais être une trahison vis à vis de mon père. Cette séquence laissera des traces jusque dans ma vie d’adulte ne supportant ni la trahison ni la déloyauté.
Henri
Mon père avait ses amis, de vrais amis. Henri, était ce qu’on peut appeler l’ami de la famille. L’ami de la famille c’est celui qui sans lien du sang, fait pratiquement partie de notre propre famille. Lorsque Henri passait, il pouvait visiter mon père, mon cousin André et mon grand-père rue Georges Courteline. Henri a connu cinq générations de Mauvy. Introduit dans la famille par mon cousin Lucien, il était surtout l’ami de mon père qu’il considérait un peu comme un grand frère. A la fin de sa vie il s’est lié à moi en souvenir de cette amitié, ainsi il a connu mes enfants et enfin mon petit fils Antoine. N’ayant pas d’enfant, il nous portait une affection comme si nous étions de sa propre famille. Henri était une personne sans aucune malice qui apportait sa fraicheur et sa perception différente du monde et de l’actualité. Il était curieux et savait nous communiquer ses impressions et ses connaissances. A 80 ans, il était encore pour mes enfants Pierre et Léo le grand copain, avec qui l’on sait que l’on peut plaisanter ou jouer sans risque. Pour mon père, quelles que soient les circonstances, il était un ami fiable. Pour moi, il était une ressource sur le plan intellectuel car il avait beaucoup lu et sur le plan de la représentation sociale. Sa mère était pharmacienne rue de Bordeaux et son grand-père avait été directeur des jardins à Tours, Henri représentait à mes yeux d’adolescent une porte ouverte sur un autre monde.
Le tonton Pierre
Pierre H. dit « tonton Pierre » était une personne très spéciale. Selon ses dires ou ce qu’il laissait dire, il avait été capitaine décoré de la Légion d’honneur militaire, curé et avocat. Son cachet d’entreprise mentionnait conseiller fiscal, ce qui en France autorise le titre d’avocat. Je me souviens surtout de son activité d’écrivain public. Pour quelques francs de l’époque il écrivait des lettres pour les uns et les autres sur un coin de table au café du Grand Marché. Au plan politique, Pierre lisait l’Action Française, seul journal que je me souviens avoir vu à la maison. Une fois par an il m’envoyait lui acheter, rue Nationale, un morceau de ruban rouge pour sa décoration disait-il. Sa mère aurait été vicomtesse. Cela ne me paraissait pas impossible car cette dame avait une vraie noblesse dans sa tenue. Elle a terminé sa vie à la cité des Sables, chez mes parents, après la mort de son fils. Elle est décédée dans sa quatre vingt dix neuvième année. La vicomtesse, la légion d’honneur, le capitaine, l’avocat, le curé, était-ce mythomanie ou réalité ? Je ne le sais pas, je cherche. Pierre avait indubitablement des connaissances juridiques de même qu’un certain savoir en latin que j’ai pu vérifier, moi-même étudiant le latin au lycée. C’est lui qui m’inspirera l’idée d’être avocat. De curé il en avait certains travers que j’ai pu constater lorsque nous partagions le même lit. Très diminué socialement et perdu dans son passé, Pierre se sentait protégé chez nous où il venait se réfugier lorsqu’il se sentait mal. Il vivait en maintenant sa dignité par sa présentation. Il avait des chaussures noires comme en portaient les curés à cette époque faites sur mesure par le cordonnier voisin. Cravates et chemises blanches, pour lesquelles sa mère retournait les cols trop usés, complétaient sa tenue. Il essayait de vivre conformément à un statut qui n’était plus le sien. Pierre lorsque la soirée bien arrosée s’était prolongée ou lorsqu’il avait un peu abusé du Corydrane restait pour dormir. Le Corydrane était un stimulant (ou excitant) très répandu dans les années 50. Constitué d’aspirine et d’amphétamines, il a été retiré du marché français en 1971. Beaucoup de journalistes et d’intellectuels, comme Jean-Paul Sartre ou Marguerite Duras, étaient de grands consommateurs de ce produit. Un cachet, ou même la moitié d’un, était suffisant pour se donner un coup de fouet. Le « tonton » poussait souvent la dose, on peut dire que certaines fois il se shootait. Il m’envoyait à la pharmacie lui acheter ses tubes.
Sans information ni accompagnement lorsqu’on est adolescent la vision de l’avenir est limitée. Il n’y avait pas de centre d’information ni de fonction de conseiller d’éducation. Fort en maths, je rêvais parfois de pouvoir devenir ingénieur comme Émile Mesgny, cousin de mon père que je n’ai jamais connu, mais dont je savais qu’il avait été ingénieur aux chemins de fer. D’où venait la rupture dans la famille, je ne l’ai jamais su. Le manque d’informations est un enfermement et une limite au développement personnel et à notre capacité à imaginer l’avenir. Au lycée je n’ai jamais eu aucune aide sans doute parce que j’étais une anomalie sociale qui n’intéressait aucun professeur. L’école ne m’apportant pas ce dont j’aurais eu besoin, j’apprenais la vie au quotidien de ce que je voyais, dans les illustrés et quelques livres que mon père aimait lire tel que « Les Pardallian » romans de cap et d’épée de Michel Zévaco.
Maurice
Je peux également dire quelques mots d’un autre ami, Maurice qui est apparu à la maison vers 1963. Mon père l’a retrouvé par hasard dans un café. Ils avaient été camarades d’école. Maurice avait disparu de la circulation après s’être engagé dans l’armée. L’armée était souvent une situation pour ceux qui n’avaient pas de métier. C’est ainsi que Maurice s’est retrouvé en Afrique pendant plusieurs années. Il était soldat de 1ère classe me semble-t-il. Après la fin de son contrat il est entré à l’AFPA comme magasinier. Le premier souvenir frappant que j’ai de lui, c’est lorsqu’il a gagné un tiercé. Il dépensait beaucoup en billets et ne sachant que faire de la petite monnaie il m’en avait donné une pleine poche, du jamais vu pour moi. Une autre fois il m’avait emmené à une fête de l’AFPA à Esvres sur Indre. En me promenant j’avise une voiture embourbée, en bon samaritain je propose de pousser. Ça n’était pas la meilleure idée d’être derrière la voiture, je me suis retrouvé rapidement couvert de boue. Maurice, célibataire et sans enfant, m’aimait bien il avait conscience de ma difficulté à vivre rue Jean Macé puis à la cité des Sables et essayait de m’aider. C’est lui qui m’a fait recruter comme traceur sur le chantier de la gendarmerie de Tours en octobre 1967. L’intention était bonne mais ce qui n’avait pas été prévu fût le changement rapide d’emploi, de traceur en manœuvre maçon. Maurice est resté longtemps dans la mouvance de mes parents y compris après mon départ. Plus tard, il fera partie avec Brigitte des personnes présentes à mon mariage. Il a fini sa vie avec pour compagne la mère de Jeannine, qui était sourde. Cette personne qui lisait sur les lèvres avait un timbre de voix particulier qu’on retrouve pour partie chez sa fille qui elle entend très bien mais qui a sans doute été marquée dans sa petite enfance par le timbre de voix de sa mère.
Bachir et la guerre d’Algérie
D’autres amis passaient régulièrement mais ne restaient pas. Bachir, un algérien très attentif à l’éducation et qui avait commencé à m’apprendre l’arabe était de ceux-là. Il venait à l’improviste et toujours chargé de provisions car il savait que nous étions souvent dans le besoin. De 1958 à 1962 c’était la guerre en Algérie. Bachir était militant du FLN (Front de Libération National Algérien) qui luttait à ce moment là contre l’OAS (Organisation Armée Secrète). Il apparaissait de temps en temps. Son activisme justifiait sans doute sa mobilité. A Tours nous étions probablement un de ses points de chute. Un jour il est venu avec un autre homme, pistolet à la ceinture. Mon père lui a demandé de ne plus revenir ainsi et nous ne l’avons plus revu. L’affaire de la station de métro Charonne, le 8 février 1962 illustre la violence à l’encontre de personnes manifestant contre l’OAS et la guerre d’Algérie. Cette époque de guerre se partage pour moi entre la mobilisation de Claude cousin de ma belle-mère et l’activisme de Bachir. Claude concentrait toute l’attention de la famille de ma belle-mère car il avait été envoyé en Algérie avec le contingent. Il avait été recueilli et élevé par les parents de ma belle-mère. Régulièrement on lui envoyait de la nourriture en conserve dans des boîtes en métal soudées.
Germain dit Neunoeil
Germain dit « Neunoeil », ce qui était inapproprié puisque Germain était totalement aveugle, faisait partie des intimes. Germain habitait La Ville aux Dames et je lui servais souvent de guide. Sa canne blanche dans la main droite l’autre main sur mon épaule il me disait d’avancer sans hésitation. Quelques fois lorsqu’il était fâché il partait tout seul la canne en avant et le pas vif. Je devais courir pour le rattraper et l’accompagner car j’avais peur qu’il se blesse. Il m’appréciait beaucoup, mais moins que ma belle-mère qu’il voyait à l’insu de mon père. Il était une source d’approvisionnement en nourriture dans les moments de pénurie. Il m’est arrivé souvent d’aller en vélo jusqu’à La Ville aux Dames pour lui demander de l’aide. Il refusait rarement, me confiant quelque fois un peu d’argent, mais plutôt l’autorisation de passer chez certains commerçants où il avait du crédit. Il savait que l’argent qu’il donnait pouvait se transformer en boisson.
Les relations
Parmi nos relations, il y avait René, cadre chez Esso qu’on voyait seulement chez lui. Il était le père de Jean-Louis, un garçon de mon âge, et le mari de Margot dit « la grosse Margot » qui à l’insu de René servait de receleuse à quelques femmes, dont ma belle-mère, qui volaient dans les grands magasins, ils habitaient place Plumereau au coin de la rue Briçonnet au dessus de l’épicerie chez Lucette. René a souvent été le dernier recours dans les moments difficiles. Il nous prêtait un peu d’argent pour dépanner et nous tirer d’embarras. C’est lui qui me fournira les quelques sous dont j’aurai besoin avant ma première paie de contrôleur aux PTT en janvier 1968.
Jean G.
Ancien déporté à Mauthausen, matricule 27150 tatoué sur le bras, libéré le 6 mai 1945 au camp de Ebensee il me fit approcher par son témoignage une réalité de plus dans ce foisonnement humain du 38 rue Jean Macé. Le nazisme et la déportation qu’on connaît par les livres d’histoire c’est différent de la rencontre avec un témoin, l’histoire devient réalité. Je ne me souviens plus des détails rapportés mais je fus surtout marqué par le matricule. J’avais déjà vu des tatouages, nombre de visiteurs du 38 en avaient, faits en prison ou ailleurs, mais un simple numéro c’était autre chose.
Mon père ne me parlait jamais de la période 39-45, sans doute trop de mauvais souvenirs et rien de très glorieux à raconter. Il avait survécu, il avait mené sa résistance individuelle et personnelle. Pour Jean, déporté politique, c’était autre chose. Il racontait comment il avait survécu en restant solidaire des autres. D’une bonne constitution c’était souvent lui qui partageait son pain. Je ne me souviens pas de tous les détails. C’était mon premier contact avec la barbarie nazie, je n’ai jamais oublié que Jean avait beaucoup de mal à vivre compte tenu de ce qu’il avait subit. Il fera plusieurs tentatives de suicide et des séjours en prison pour être à l’abri l’hiver. C’est un joli mot solidaire, un de ceux qui ont rempli ma conscience. .La conscience c’est comme un vase il se remplit goutte après goutte.
Je ne vais ici décrire tous les personnages qui défilaient à la maison, les uns amenant les autres, du vieux chiqueur qui avait fait le « Chemin des dames » en 14 aux rejets de prison plus ou moins violents. C’est avec tous ces personnages plus ou moins naufragés que j’ai appris la vie durant cette période. L’apprentissage des rapports humains, la découverte de la sexualité, l’observation du fonctionnement de la société vis-à-vis des pauvres, j’avais tout cela en direct sans pouvoir en parler à l’extérieure par honte de ce milieu déchu et le plus souvent insupportable.
La famille de ma belle-mère
Ma belle-mère originaire de Blain avait une sœur, Monique, mariée à un artisan couvreur. Ils habitaient, avec la grand-mère, la maison de famille construite par le grand-père Louis, décédé avant mon arrivée. Il était menuisier, capitaine des pompiers et communiste. Je ne l’ai pas connu mais j’en ai beaucoup entendu parler. C’était un homme droit et soucieux de moralité, ce qui l’avait conduit à chasser sa fille ainée, ma belle-mère, tombée enceinte sans être mariée. Plus tard il l’établira en lui finançant un commerce de vin à Nantes.
Je connu cette nouvelle famille l’été 1959 la même année que je découvrais la mer à Penestin près de Piriac en Bretagne en leur compagnie. Pierre et Monique ne pouvaient pas avoir d’enfant et c’est sans doute pourquoi ils furent très heureux de m’accueillir chez eux en vacances. Ce fut pour moi l’occasion de m’initier au métier de couvreur en grimpant sur les toits et en montant les ardoises à l’épaule. En échange de mon travail, j’avais le droit de conduire la camionnette Peugeot 203 assis sur les genoux de l’oncle Pierre. Il m’appréciait beaucoup car j’étais attentif et travailleur. C’est aussi avec Pierre que je ferai l’expérience des battages à l’ancienne.
Au début des années 60, il y avait peu de ces monstres qu’on appelle moissonneuse-batteuse. On coupait les blés d’un côté puis une batteuse s’installait dans la cour d’une ferme et on battait la récolte. Elle crachait les grains et ficelait les bottes de paille. A l’arrière de la batteuse sortaient les résidus, il fallait dans la poussière tirer ces restes à la main. Ce fût ma mission, je m’en souviens encore, ce n’était pas agréable du tout bien que mes poumons aient oublié cette maltraitance.
Il y avait les compensations, j’avais des vraies vacances à la campagne, au bord de la mer et j’ai même participé à un voyage à Lourdes. Cela avait été un compromis entre la grand-mère très croyante qui voyait dans ce pèlerinage l’occasion d’intercéder pour son frère atteint de la maladie de Parkinson et Pierre incroyant avéré, plutôt du bord de son beau-père, qui a vu l’opportunité de voir à Lourdes une étape du Tour de France. Ce voyage à Lourdes me permettra un devoir de classe avec documents sur le sujet. J’avais eu des vacances exceptionnelles dont je pouvais parler. Quant à l’oncle Georges parkinsonien à un stade avancé, cela n’a changé grand-chose, il est décédé un an plus tard.
C’est aussi à Blain que j’appris qu’on pouvait pêcher à la dynamite, un cousin de la famille, un peu braconnier, était manchot à cause de ce type de pêche et d’un bâton allumé qu’il lance trop tard. Le principe de cette pêche interdite consiste à bombarder une zone dans un étang ou en mer, ce qui envoie une puissante onde de choc et ainsi tue les poissons aux alentours. Il suffit après de les récolter à la surface.
La dernière année, je devais avoir 13 ans et demi, j’ai pu parcourir la campagne en Solex pour essayer de récolter, dans quelques fermes, le paiement de petites factures oubliées. Le plus souvent je revenais avec des pommes de terre ou du lait caillé pour faire patienter.
Mes amis personnels
« Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse » Pythagore
En décembre 1958 je rentrais à l’école Jean Macé. Mes parents fièrement dirent à l’institutrice que j’étais un bon élève. Après le premier devoir celle-ci se fera un malin plaisir à me dire que vu ma note si j’étais le meilleur, qu’en était-il des autres. Certains membres du corps enseignant m’ont toujours surpris par leur indélicatesse à l’égard des enfants. Bien sûr, mes qualités se révélèrent dans les semaines suivantes, et toc pour la maîtresse! L’année suivante, en CM2 chez Monsieur D, enseignant heureusement plus attentionné à ses élèves, je pourrai encore plus m’affirmer. Mis à part « mes gros boudins », souvent dénoncés par celui-ci car j’avais une très mauvaise écriture, mes autres qualités étaient reconnues. A l’école primaire je me suis lié d’amitié avec deux camarades Jean-Yves et Jacques. Ces deux amis d’école seront aussi mes amis au collège et au lycée, les autres étant seulement des amis de sorties, ceux avec qui on « traine ».
Jean-Yves
C’était un garçon doux et gentil, très doué en mathématiques ainsi qu’en dessin. Côté physique il était de type fluet et très peu doué pour le sport. Il était craintif, mais avec moi comme disent les enfants, « personne ne venait l’embêter ». Cela faisait partie de notre amitié. Ses parents étaient d’une nouvelle classe sociale en développement dans les années 60, la classe moyenne. Son père était cadre chez Biemont, entreprise de chaudronnerie qui a construit de nombreux mobiles de Calder, sculpteur renommé qui a révolutionné la sculpture, art du volume, en lui apportant mouvement et couleurs. Plus tard j’aurai comme ami, à la cité des Sables, Marc un chaudronnier qui travaillait dans cette entreprise. Il a sans doute participé au façonnage des Calder. En rentrant du lycée j’accompagnais Jean-Yves chez sa grand-mère au Placis de La Riche derrière l’église Notre Dame la Riche, puis après que le Placis fut détruit rue du Camp de Molle dans un bâtiment nouvellement construit. C’était une bonne étape en revenant du lycée. La grand-mère de Jean-Yves était très gentille et je passais un peu de temps chez elle pour faire nos devoirs ensemble. Cette amitié me faisait accéder à un monde au dessus de ma condition et m’ouvrait des espaces nouveaux.
Jean-Yves fera de brillantes études pour finir ingénieur chez l’Oréal aux États Unis. J’ai eu de ses nouvelles grâce au réseau sur Internet. A mon étonnement il se souvenait parfaitement de moi et de ma position sociale difficile à ce moment. Il s’est réjoui avec délicatesse de mon ascension sociale.
Jacques
Son père, d’origine arménienne, était pâtissier. Il cessa d’exercer assez tôt pour raison de santé. Il eut droit à une maigre pension car son employeur avait omis de déclarer toutes ses heures de travail, ce qui était fréquent dans ces années là.
La mère de Jacques était une femme très pieuse qui fréquentait souvent l’église de l’abbé Payon curé de Notre Dame la Riche. Elle appréciait ma façon d’être toujours bien coiffé et me donnait en exemple à son fils. Heureusement elle habitait au 10 à l’autre bout de la rue Jean Macé et n’avait pas idée des turpitudes du 38, à moins qu’elle n’ait été assez généreuse de ne pas me confondre avec mes parents.
Jacques avait trois sœurs, Gisèle l’ainée mariée à un « con » disait Jacques, mais heureusement cocu par le patron de sa femme. Sa seconde sœur Christiane était une femme célibataire et très libre. Elle me fera beaucoup rêver par sa beauté et sa liberté de tenue. Elle était serveuse de bar et plus tard tenancière d’un café rue Georges Courteline au dessus duquel Jacques aura une chambre. La plus jeune Chantal était une écolière blonde et discrète. C’est par Jacques que j’aurai connaissance du génocide arménien. Cette connaissance là on l’apprend dans les manuels scolaires mais on comprend mieux au contact des gens qui l’ont vécu. Ce sera le cas bien souvent dans ma vie, chaque histoire humaine croisée sera une fenêtre ouverte sur l’histoire du monde.
Jacques est celui avec lequel j’ai partagé le plus de temps. Il était volage en amitié mais ma constance compensait. Du point de vue social, bien que peu riche, il était beaucoup plus à l’aise que moi. A son mariage auquel j’étais son témoin, j’ai revu sa famille. Je me souviens qu’à cette occasion sa sœur Christiane, toujours égale à elle-même, s’était fait remarquer par une belle robe qui laissait apparaître une partie de son corps nu. Cela avait fait scandale, notamment du côté de la famille de la mariée. Jacques est devenu avocat. Après une période de fréquentation jusque dans les années 80 nous nous sommes éloignés. Maître Jacques réside toujours à Tours mais nous ne nous voyons plus.
Mes autres connaissances
A l’école primaire je m’étais aussi lié avec un autre enfant : Nicaise. Il était très pauvre et avait la tête rasée à cause des poux. Les autres enfants ne lui parlaient pas. J’étais le seul à lui témoigner un peu d’amitié. Je n’ai jamais oublié un cadeau qu’il me fit, une boîte de crayons de couleur. Devant mon insistance, il m’avoua l’avoir volée pour m’en faire cadeau.
Il y avait aussi Gilles dit « Gillou ». Nous n’allions pas à l’école ensemble, je le connaissais par mes parents en relation avec sa mère. Son père, Jean, un gitan sédentarisé comme toute sa famille, était un homme taciturne. Il ne faisait rien d’autre dans la vie que de pêcher. Il faut dire qu’à cette époque la Loire était généreuse en brochets, sandres, perches, chevesnes ou carpes et mulets de Loire. Il y avait même des écrevisses. De nombreux bourgeois tourangeaux ont dégusté le fruit de la pêche de Jean le manouche revendue à la poissonnerie de La Criée aux Halles.
Les filles
Côté sentiments, vers onze ou douze ans, j’ai eu une petite amie, Mercédes dont la mère tenait une épicerie bar rue Rouget de l’Isle. Elle m’aimait beaucoup et me faisait des cadeaux. Je me souviens d’une voiture modèle réduit qu’elle m’avait achetée pour que je puisse faire comme les autres garçons à l’école des courses de caniveau. Il s’agissait de propulser avec le doigt le modèle réduit dans le caniveau le long du trottoir ou sur des parcours créés pour l’occasion. C’était une alternative au jeu de billes. Ce genre d’amour d’enfant dure ce qu’il dure, c’est à dire pas longtemps ou pour la vie.
Un peu plus tard, la recherche de petites amies est devenue une préoccupation assez constante comme pour tout adolescent. Mon problème n’était pas la timidité, mais le doute sur ma condition sociale et une certaine difficulté à m’affirmer entre désir et sentiment.
A seize ans, j’ai connu Jacqueline, ma première vraie relation ce qui a sans aucun doute perturbé ma classe de seconde car j’ai pas mal séché le lycée pour la belle. Jacqueline m’avait été amenée par mon chien Nasser un soir de promenade. Nasser était un berger allemand sans doute dégénéré car très doux voir craintif. La seule chose qui le rendait hargneux c’était les uniformes. On disait qu’il avait appartenu à la police qui n’avait pas réussi à en faire un chien policier et l’avait pour cette raison, maltraité puis abandonné à la SPA. Nasser est sans doute arrivé à la maison par l’entremise d’Henri dont c’était la spécialité d’avoir des chiens dont personne ne voulait. Lui même avait un chien borgne « Coclès » du nom du héros romain Horatius Coclès. Il l’avait pris parce qu’il savait que personne ne voudrait d’un chien borgne et que ce chien finirait euthanasié.
Je me souviens bien du soir où j’ai vu arriver Nasser poursuivi par un caniche derrière lequel courait Jacqueline. A partir de ce jour, tous les soirs j’allais promener Nasser avec grand plaisir. Quelques fois par manque d’attention de ma part, étant trop occupé par ailleurs, le chien rentrait tout seul. Je prétendais alors que je l’avais cherché. La mère de Jacqueline tenait un commerce rue des Halles ce qui était bien pratique car nous savions quels étaient ses horaires. Cela m’a permis de passer de longs moments de flirt chez Jacqueline. Elle devait juste retrouver sa mère au magasin vers 17 heures. J’ai du faire beaucoup de faux mots d’excuse pour mes absences de cours l’après-midi, la non-concordance des horaires était un vrai problème. En général je finissais l’après-midi chez mon oncle André autour d’un petit café crème. Mon amour d’adolescent prit fin avec ma relégation à la cité des Sables.
Reprise de contact avec la famille
En 1958 lors de mon arrivée à Tours, mes grands-parents demeuraient au 77 de la rue Georges Courteline et mon oncle André rue du Champ de Mars à côté de l’ancienne maison close l’Étoile Bleue. En 1962 mon cousin André ira habiter rue des Quatre Vents ce qui fera une quantité importante de Mauvy dans le quartier des Halles. Si j’ajoute ma grand-tante, Augusta, qui tenait épicerie avec son mari Louis Besnard sur le Placis de La Riche et ma tante Didine dans un passage qui donnait rue du Champ de Mars, j’étais vraiment chez moi dans ce quartier.
Malgré tout ce monde je me sentais seul et isolé, sans doute à cause de la vie désordonnée de mes parents et à cause de mon retour tardif à dix ans dans cette famille qui ne me connaissait pas. Le peu de contacts que j’ai eu avec mon grand-père m’a permis d’apprendre à jouer à la belote et connaître son poisson-chat Toto. Que puis-je reprocher à des grands-parents qui ont ignoré ma mère et qui n’ont pas eu l’occasion de me connaître dans ma petite enfance ? Il est vrai qu’ils ont eu leur dose de soucis avec la famille. Après la mort en couches de leur fille Noëlla pendant la détention de 1927 à 1936 de leur fils ainé, ils ont élevé leur petit fils André, puis se sont occupés de sa fille Lydia à la séparation de celui-ci d’avec sa femme Éliane. Il n’y avait sans doute pas de place pour un petit fils revenant. Chassé de leur logement, après un très bref passage rue Jean Macé, ils auront un logement à la cité des Sables à La Riche où ils résideront parmi les premiers habitants de la cité. Ils seront rejoints plus tard par mon cousin André et mes parents, cela fera de la famille Mauvy une référence dans la cité, piètre consolation en ce lieu d’abandon, mais qui me facilitera la vie parmi des jeunes de la cité souvent délinquants.
Le quartier des Halles
Le quartier de la rue des Tanneurs à la rue du Grand Marché, avant la reconstruction du quartier dans les années 70, était un coupe-gorge la nuit mais un monde très vivant le jour. Le café du Grand Marché, chez Marie la bretonne, était le point d’attache régulier de ma belle-mère et le bureau du tonton Pierre. J’y étais connu et apprécié. Je rendais des petits services dès qu’il y avait un besoin. Pendant trois ou quatre ans ça a été ma source de revenus du mois de mai. Le muguet de mai était un moyen que j’avais trouvé pour me faire quelque argent. J’achetais un petit bouquet de quelques brins dès le matin et j’en offrais un brin à toutes les personnes que je connaissais en commençant par le café du Grand Marché où je savais faire le maximum. Le capital se trouvait rapidement multiplié. Proche des Halles, le café du Grand Marché avait ses habitués. On y croisait Pierre, Germain et tous les amis. C’était un café tranquille dans la journée, seules les soirées pouvaient être agitées. J’ai été témoin de bagarres où les protagonistes s’affrontaient au couteau ou avec des tessons de bouteilles, ce qui a du laisser quelques balafres. Il y avait là une faune guère rassurante que j’ai eu l’occasion de côtoyer lorsque mes parents oubliaient de rentrer et que j’étais avec eux.
Des Halles jusqu’à la rue du Grand Marché c’était grouillant de vie autour des commerces de bouche. Ma belle-mère était très connue car elle y passait, chaque matin, le plus clair de son temps autour de petits verres de blanc. Ce sont sans doute ses petits blancs qui expliquaient sa hargne à mon égard, le vin pouvant engendrer une certaine stimulation émotionnelle. A la fin de sa vie c’est sans doute aussi tous ses verres qui seront la cause de ses hémorragies intestinales.
Le cinéma de quartier
Au début des années 60, le cinéma est la principale distraction, la télévision est à son début. Tout le monde avait la même chaîne, encore fallait-il avoir un téléviseur. Nous en aurons un vers 1962 avec une tirelire sur le côté. C’est ainsi que beaucoup de familles ont eu la télévision. Le commercial plaçait le poste qui était payé grâce à la tirelire. Quelque fois le représentant venait récupérer le poste car il n’y avait pas assez dans la tirelire. D’autres fois, des gens enlevaient la tirelire et portaient le poste chez « ma tante », c’est à dire au Mont de Piété. C’était un moyen d’avoir un peu d’argent immédiatement grâce au prêt sur gage. On déposait les objets de toutes sortes et on recevait en échange une somme d’argent. On disposait d’un certain délai pour faire l’opération inverse moins un prélèvement pour le prêteur sur gage. Pour le représentant de commerce qui avait installé le poste c’était transparent ou certaines fois une perte sèche. De 1958 à 1962 ma distraction principale était la radio avec le journal de Mickey et le feuilleton radiophonique Zorro.
Pour le cinéma il fallait un minimum d’argent que je n’avais pas toujours. Le Family rue d’Abilly et le Ciné Lux rue Léon Boyer étaient les cinémas du quartier, le Caméo était en centre ville. Le Family était plus confortable que le Ciné Lux qui avait des sièges en bois. Le Family était un bon cinéma pour la sortie de fin de semaine des familles. Le Ciné Lux était du genre cinéma de patronage. Au début des années 1960, Tours comptait douze salles de quartier pour huit salles de centre-ville. Mais l’essor des loisirs et de la télévision en particulier entraîna une désaffection des salles qui se traduisit par un mouvement de centralisation. Les salles de quartier beaucoup moins attractives que celles du centre ont fermé les unes après les autres. À Tours, à partir de 1960, sur les douze cinémas de quartier, huit ont fermé en l’espace de dix ans.
Je devais me battre pour trouver l’argent nécessaire pour aller au cinéma. Pour payer ma place le jeudi à la séance scolaire je récupérais des métaux que je vendais au chiffonnier et récupérateur de la rue Léon Boyer. Il n’y avait pas grand chose, de l’aluminium ou du plomb autour des goulots de bouteille, quelques fils de cuivre mais ça suffisait. J’avais appris la valeur du métal en faisant la « biffe » avec mon cousin André. Ayant l’habitude de me voir, le marchand ne pesait plus, il me donnait directement le prix de ma place. Il savait que je venais le jeudi matin pour la séance à tarif réduit du jeudi après-midi au Caméo. C’était un brave homme qui avait du cœur. Il ne faut jamais désespérer des humains, il y en a toujours au moins un pour racheter les autres.
Monter le charbon chez la maman du tonton Pierre de la cave au troisième étage au 30 rue Jules Charpentier dans l’impasse faisait partie de mes autres sources de revenu. Mais ce revenu là était surtout pour payer mes livres scolaires. Les petits classiques Larousse n’étaient pas chers mais pour les plus démunis c’était déjà beaucoup, et les professeurs de français ne se posaient pas la question de connaître l’état de vos moyens. Depuis Jules Ferry l’école est gratuite mais seulement l’école élémentaire. Pour le collège et le lycée c’était autre chose. La maigre bourse que percevaient mes parents servait seulement à payer la cantine du midi, mais revenons au cinéma.
Les samedis où je n’avais pas assez pour payer ma place au Family, je guettais mon oncle André à l’extérieur pour compléter mes maigres ressources. Le Family avait un bar ce qui permettait aux spectateurs à l’entracte de siroter un verre et de se rencontrer. Sachant toujours y retrouver mon oncle je profitais de l’occasion pour me faire offrir une limonade. Les grands cinémas du centre ville ont longtemps été trop chers pour ma bourse. Je n’y aurai accès que plus tardivement lorsque j’aurai la possibilité de travailler aux halles à décharger les légumes.
Les petits boulots
Dès l’âge de 14 ans j’ai cherché à travailler, c’était l’âge légal pour un emploi. Mon oncle André, plombier à la brasserie St Éloi, connaissait presque tous les cafetiers de Tours chez qui il intervenait sur la plomberie de leur machine à bière. Mon oncle me présenta à un garçon de café employé au café de la Bourse rue Nationale qui pouvait me faire embaucher. Je me souviens de ce premier contact car c’est à cette occasion que j’ai appris comment mettre une poire dans une bouteille, il suffit de la faire pousser dedans. Sur recommandation du garçon, le café de la Bourse rue Nationale m’offrit un emploi de barman rémunéré au pourboire. J’étais très bien nourri et payé comme les garçons par les pourboires des clients. Le patron était un auvergnat qui faisait de la bonne cuisine et savait reconnaître un bon travailleur. Il savait aussi faire respecter son personnel, pour un barman de 15 ans à peine il était une bonne protection. Tout le monde savait comment ça fonctionnait pour le salaire mais ça n’empêchait pas certains d’oublier le pourboire ou d’être méprisant pour le personnel de service. L’année suivante, j’ai fait une saison au Continental avenue de Grammont.
La corporation des garçons de café était très installée à Tours à cette époque et pourvu qu’on respecte les règles et qu’on sache y faire on gagnait bien sa vie. Chaque année avait lieu la course des garçons de café sponsorisée par la brasserie St Éloi. Il s’agissait d’une course de vitesse en centre ville plateau en main. Cette manifestation était très suivie, c’était une bonne publicité et l’occasion d’attirer l’attention sur le métier de garçon de café.
En 1965 j’ai eu mon premier contrat saisonnier en restauration à Villefranche sur Cher. J’étais nourri et logé et payé au pourboire. Cette expérience m’a fait découvrir les clients touristes. Le commerce était un hôtel restaurant avec pension. Il y avait le passage et les vacanciers pensionnaires, nous étions trois pour servir. Le patron était à la cuisine et la patronne à la caisse. L’établissement s’est révélé un mauvais lieu de travail. La nourriture était composée des restes des clients et les patrons n’avaient aucune considération pour le personnel. Après plusieurs protestations de ma part le climat était un peu tendu, d’autant que j’avais le soutien des clients mécontents de la nourriture. L’affaire s’est terminée de manière brusque. Christiane et Jacques étaient passés me voir, je leur ai demandé s’ils avaient une place dans leur voiture et j’ai donné mon compte sans préavis. Les deux serveuses, anciennes dans la maison ont décidé de me laisser l’ensemble des pourboires de la journée. J’ai appris que quinze jours plus tard elles avaient démissionné. J’avais réveillé le personnel face à de mauvais patrons. Ce n’était pas une mince victoire. J’ai de cette période deux souvenirs mémorables. Le premier c’est que j’ai perdu, entre Romorantin et Villefranche, une chaussure de la paire que je venais d’acheter. J’avais mis la paire mal attachée sur le porte bagage du vélo, résultat une perte sèche car je ne connaissais pas d’unijambiste. Le second est une rencontre lors d’une promenade au bord du canal de Berry. Il s’agissait d’un homme qui avait pas mal bourlingué et qui m’a montré un magnifique tatouage d’un papillon occupant tout son dos. Il m’a permis de le photographier, hélas en noir et blanc.
L’année suivante, en 1966, je m’en souviens à cause de la coupe du monde qui mobilisait l’attention et fut gagnée par l’Angleterre, j’étais au Buffet de la gare de Tours en vente ambulante. C’était aussi l’année du renvoi des troupes américaines de France suite à la décision du général De Gaulle. Pour cette dernière place il fallait être un peu tricheur pour s’en sortir. On prenait les bières, les sodas, les glaces et les sandwichs au Buffet, le soir on faisait l’inventaire des restes et on payait la différence. Sur les quais on comprend vite qu’entre la patronne qui cherchait toujours à tirer sur l’inventaire et le coulage dû aux vols on ne peut pas rester intègre bien longtemps. Il faut savoir profiter de tout, par exemple en vendant des bières au dessus du prix aux militaires américains basés à St Benoit la Forêt, suant dans leur uniforme et qui n’avaient pas de monnaie française. Le paiement en dollars est accepté mais avec un change très défavorable. On pouvait aussi faire en sorte qu’un peu de monnaie tombe sur la voie et la récupérer quand le train était parti. Ou encore on s’arrangeait avec les agents de la SNCF, ils ramassaient les bouteilles sur les voies et on faisait moitié-moitié à la revente car les bouteilles étaient consignées.
Pendant l’année scolaire, j’avais travaillé de nuit aux Halles pour décharger les légumes à répartir dans les camions. Le marché de gros fonctionnait de minuit à six heures, les horaires me permettaient d’aller en classe. J’avais également donné des cours à un gamin pour son entrée en sixième. J’espère qu’il a réussi sa scolarité et qu’il se souvient encore de la règle d’accord du participe passé.
La cité des Sables
« Y’a des tas d’ambitieux qui s’acharn’nt à la peine
Pour ramasser trois cent mille francs,
De quoi s’ach’ter plus tard un castel en Touraine :
Faut vraiment pas être au courant !
Y’a qu’à s’am’ner comm’ ça, simplement, un dimanche,
Avec des planches et des outils,
Pour se construir’ soi-même sa villa Les Pervenches
Ou son p’tit chalet Ça m’ suffit ! » La Zone, chanson de Fréhel (1933)
A la mort de notre logeur, la propriétaire refusa de nous relouer l’appartement et décida de nous faire expulser. Pour hâter notre départ elle nous coupa l’électricité, le compteur était chez elle. Nous sommes restés plusieurs mois sans la lumière électrique. L’abbé Payon était le curé de Notre Dame la Riche, paroisse dont dépend la rue Jean Macé. C’est le prêtre qui m’a conduit à la communion solennelle et confirmé, m’apportant la lumière de dieu. En 1965, il m’apporta la lumière, au sens propre cette fois ci, car ce sont des restes de cierges qui m’ont éclairé pour faire mes devoirs pendant une partie de mon année de seconde. Je ne fréquentais pas l’église car ma foi avait été de courte durée n’ayant pas eu la montre qu’on m’avait promise pour ma communion. Nous aider à nous éclairer était pour l’abbé Payon une manière de venir en aide aux pauvres. Je choisis encore aujourd’hui de lui en être reconnaissant à défaut de l’être pour ceux et celles qui payaient les cierges et faisait des vœux en les allumant. Ce pouvait être ceux de la propriétaire.
Les détours de la vie sont toujours très étranges. En arrivant à Avon les Roches je me suis intéressé à l’histoire locale et au massacre de Maillé, j’ai découvert à cette occasion le parcours de l’abbé Payon. Il avait été le curé du village au moment du massacre. C’était comme un pont entre mon présent et 1965 au 38 de la rue Jean Macé. La vie est comme une rivière qui serpente pendant des dizaines voir des centaines de kilomètres sans savoir par avance quels paysages elle va rencontrer ni dans quelque autre rivière elle va se fondre. Au final, elle ne sait pas dans quelle mer elle va se jeter. Nous, les hommes, suivons un chemin fait de hasards et savons que cette mer finale est la mort qui nous emportera dans un monde dont nous ne connaissons pas les rivages.
La cité
Après presque un an sans électricité on nous a proposé un logement, à la cité des Sables, commune de Tours mais en fait sur le territoire de La Riche. La cité des Sables était à six kilomètres du centre de Tours. C’était un ghetto coincé entre la ligne de chemin de fer Tours à Nantes, la décharge municipale, les jardins ouvriers et le Cher. C’était un monde délibérément clos. Pendant longtemps les bus se sont arrêtés à Port-Cordon, il y avait encore un kilomètre à faire pour aller aux Sables. La cité a compté près de deux mille habitants. Elle avait très mauvaise réputation. Dans cette cité d’urgence bâclée en 1954, l’isolement était la règle. La majorité des gens sont restés là pendant 20 ou 30 ans jusqu’à sa destruction dans les années 90. Il y avait malgré tout une certaine solidarité et à part quelques trafics et des bastons de temps en temps, ça n’avait rien à voir avec Chicago. Il n’y avait pas de gros bonnets seulement des jeunes loubards livrés à eux-mêmes dans des familles mangées par la misère et pour certains l’alcool. Les gens se connaissaient et par la force des choses se supportaient. La population entrait et sortait par le même endroit, ils se voyaient. Il n’y avait pas de dégradations volontaires mais la mauvaise qualité des matériaux rendait difficile l’entretien. Ça cassait facilement, en conséquence il y avait un laisser aller général, rien à voir avec Le Corbusier et ses maisons Radieuses. L’ambiance et l’environnement m’interdisaient de faire venir des copains de classe habitant les quartiers respectables de Tours. C’était pour moi une sorte de relégation, je ne voyais pas comment en sortir.
J’étais le seul lycéen à la cité car l’échec scolaire était général. Il y avait impossibilité pour moi d’avoir des amis parmi mes pairs, ni même de maintenir certaines amitiés existantes. La découverte d’un milieu aussi particulier était inacceptable pour mes camarades de classe. La mixité raciale, le chaos familial, les bagarres incessantes dans notre F2 et l’état lamentable de la cité auraient découragé les plus généreux. J’étais exclu définitivement de mon groupe social précédent. J’ai réussi à m’intégrer à ce nouveau monde parce que le nom des Mauvy était connu et que j’ai pu m’y faire un ou deux amis avec qui je sortais le samedi soir pour aller au cinéma ou trainer en ville.
Mes nouveaux amis
Marc et Dominique étaient au dessus de la moyenne. Marc avait un CAP de chaudronnier et Dominique un CAP de boulanger et ils travaillaient régulièrement. Ce sont souvent eux qui finançaient mes sorties car je n’avais pas beaucoup plus d’argent qu’avant, et moins de moyens pour en gagner. Ce fût une période très difficile et j’ai voulu à plusieurs reprises partir mais pour aller où ? De plus j’étais mineur car la majorité était à 21 ans. Une partie de mon échec en fin d’études est sans aucun doute liée à la cité et à la mauvaise ambiance chez moi. Comment se motiver dans une telle situation ?
Il y avait aussi dans ce bas monde multiracial des fenêtres sur d’autres univers. Ceux qui étaient là ne l’avaient pas choisi, c’était un peu comme si ils y étaient tombés depuis la société normale. Plus bas c’était la rue. J’y ai connu un ancien trompettiste de l’orchestre de Ray Ventura, André. On n’est jamais vraiment pauvre lorsqu’on possède un instrument de musique. La musique est une richesse qui appartient à tous, c’est un commun. Cet homme déchu, à chaque passage de l’orchestre auquel il avait appartenu se mettait sur son « 31 » pour aller déjeuner avec les musiciens au restaurant Le Lyonnais, rue Nationale à Tours. Je m’étais lié d’amitié avec lui car je m’intéressais à son histoire. J’ai gardé de lui un vieux dictionnaire Larousse qu’il m’avait offert et le témoignage écrit de son amitié, « à mon jeune ami ».
Il y avait également à la cité une communauté de prêtres ouvriers dont le père Léon Gahier. Celui-ci appréciait particulièrement la capacité de ma belle-mère à créer du lien social. Notre appartement, aux Sables, comme le 38 rue Jean Macé, était en effet une plaque tournante entre les différents mondes de la cité. On y voyait passer les femmes battues, les garnements faisant l’école buissonnière, ceux qui avaient besoin de réconfort et qui cherchaient une solution ou tout simplement ceux qui venaient boire un verre. Le père Léon me confirma cela, vu d’un œil extérieur, lorsque je le reverrai en 2001 à l’occasion d’un débat sur la laïcité à Tours ; après tout ce temps, il se souvenait de nous. Ce qui était important à ses yeux était la capacité d’accueil pas les désordres personnels. Nous n’avions pas le même regard sur la chose.
Le père Léon œuvrait pour le compte de dieu dans notre cité, aux Sables. Nous étions en quelque sorte une de ses paroisses. Les prêtres ouvriers dans la tradition du catholicisme social apparaissent dès le début du XXe siècle ce sont des initiatives individuelles. Ils sont confrontés à la déchristianisation et à la misère des ouvriers dans les villes à la suite de la révolution industrielle. Par la suite, au sein de la Jeunesse ouvrière chrétienne des aumôniers prennent conscience que la paroisse traditionnelle est essentiellement bourgeoise, accaparée par les problèmes matériels, les exigences du culte et les œuvres. Ce type de paroisse est coupé du milieu ouvrier déchristianisé. Lors de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux prêtres et séminaristes sont mobilisés voire réquisitionnés. Ils sont confrontés aux tristes réalités du quotidien de la guerre (camp de prisonniers ou de déportation, résistance, STO) et réagissent face à l’attitude de l’épiscopat français qui est dans la première partie de la guerre « maréchaliste » . Après 1945, un certain nombre de prêtres commencent à vivre leur ministère en usine. Épousant les espoirs et les combats de leurs collègues, ils s’engagent dans les associations, syndicats (essentiellement la CGT) et même les partis politiques, ce qui provoque la méfiance de Rome. Bien que non membres du Parti communiste, ils manifestent régulièrement à ses côtés en dépit d’un décret du Vatican qui le leur interdit en juillet 1949, et participent aux grèves. Dans le contexte de la guerre froide, le pape Pie XII, qui craint entre autres leur imprégnation par le Parti communiste français décide en 1954 d’arrêter l’expérience des prêtres ouvriers en leur demandant de se retirer des usines. Ils sont alors une centaine. La plupart obéissent et démissionnent de leurs emplois, mais quelques-uns restent au travail, en se mettant ainsi consciemment en faute vis-à-vis de l’Église. Le père Léon était de ceux-là. La situation se retourne complètement en 1965, après le concile Vatican II ; le 23 octobre 1965 le pape Paul VI autorise à nouveau aux prêtres le travail dans les chantiers et les usines. En 1976, ils atteignent le nombre de 800 en France.
Le père Léon, de l’ordre des capucins, a été parmi les premiers prêtres-ouvriers, prêtre pour « le peuple des usines et des quartiers » selon lui. Il était un prêtre parmi les travailleurs salariés. Les prêtres-ouvriers, étaient au boulot, confrontés à la réalité ouvrière et aux conditions de travail dures. Il vivait en « laïcité » qui permet le dialogue entre les croyants et les non-croyants. C’était un homme vrai qui s’adressait à ceux qui ne sont pas dans le cercle uniquement religieux : les travailleurs, les chômeurs, les petites gens, les militants, tout simplement le peuple des usines et des quartiers. Il est mort en 2019 à plus de 100 ans. Parmi ses dernières paroles rapportées par la presse, je retiens celles-ci « Je ne vois pas d’opposition entre la politique et le mystique, ça va ensemble… même si ça n’en a pas l’air. Quand on a découvert cela, on est libre, on dépasse les appareils et on trouve la fraternité d’un peuple. Il n’y a pas de classe sociale dans le cœur de Dieu, il n’y a que des frères et des sœurs ». C’est aussi vrai pour certains incroyants comme pour moi.
Tous les handicapés de la vie qui défilaient chez moi m’ont aidé à voir qu’il y avait plus d’espoir dans mon malheur que dans le leur, mais à l’adolescence on est égoïste et on pense surtout à soi. Je n’ai su que beaucoup plus tard, qu’il ne faut pas regarder seulement au dessus de soi mais aussi au dessous, il y a beaucoup à apprendre. J’ai quand même retenu que la solidarité est à la base de toute société. Dans la devise de notre République française cela s’appelle « fraternité » mais beaucoup ont oublié ce que cela voulait dire.
Dans son roman autobiographique, Stéphane Audeguy décrit la cité des Sables qu’il voyait depuis les jardins ouvriers auxquels il se rendait avec son père et son grand-père. Ce regard peut paraître un rien négatif mais il est très juste et peu de chose à côté de la façon dont les nantis tourangeaux considéraient la cité.
« Ce grand-père et son fils cherchaient confusément à compenser leur détachement du paysannat en entraînant chaque fin de semaine leur famille sur des terrains pauvres et inondables entre Cher et Loire, situés à deux pas de Tours sur le territoire de la commune de La Riche, parce que la SNCF proposait là des jardins à son petit personnel. Lesquels jardins s’étendaient sous les fenêtres d’une cité d’urgence édifiée entre 54 et 57. Construite en réaction au fameux appel de l’abbé Pierre pour sortir certaines populations des bidonvilles où la crise de l’après-guerre les avait jetées, ces ensembles abritèrent toutes sortes d’ouvriers miséreux, de familles sans feu ni lieu … Mais on créait ainsi une situation tendue où se faisaient face, et à la longue s’affronteraient, trois variétés de pauvres : l’ouvrierSNCF, qui était un peu, en ce temps d’après-guerre et de Parti communiste… l’aristocrate du prolétariat, de véritables prolétaires, c’est-à-dire des individus non imposables et grands pourvoyeurs d’enfants, enfin un sous-prolétariat qui aspirait à ce qu’il pouvait, c’est-à-dire fort peu de choses. ».
C’est au cours des années 70, alors que j’étais déjà parti, que s’installèrent à la cité les familles maghrébines qui devinrent rapidement majoritaires. Mes parents allaient rester là jusqu’à la mort de mon père en 1990, en parfaite intelligence avec cette nouvelle classe de « prolétaires racisés ».
Mes années lycée
« Parler est bien, écrire est mieux ; imprimer est excellente chose. Car si votre pensée est bonne, on en profite ; mauvaise, on la corrige et l’onprofite encore. » Paul Louis Courier Pamphlet des pamphlets
A la rentrée de 1960 j’ai intégré le collège/lycée Paul Louis Courier dont dépendait l’école Jean Macé, J’y ai fait toute ma scolarité secondaire. Jusqu’en troisième j’étais un bon élève et j’avais réussi à me faire de bons amis de classe. Outre Jacques et Jean-Yves je m’étais lié d’amitié avec quelques autres. Certains, surtout ceux d’origine modeste, quitteront le collège rapidement, les autres resteront mes camarades de classe jusqu’en première pour les devoirs en commun. J’apportais mes capacités et eux m’offraient les espaces de travail dont je manquais. Cela n’allait pas souvent plus loin car je n’ai jamais pu les recevoir chez moi.
A partir de la rue Jean Macé, pour me rendre au lycée, j’avais deux chemins possibles soit par la rue des Halles soit par la rue Colbert. Lorsque je prenais la rue des Halles je passais devant chez ma grand-tante Eugénie, au coin de la rue Jules Moineaux et de la place François Sicard. Je ne la connaissais pas et je n’ai jamais osé me présenter. Je savais par mon père qui elle était mais il n’avait pas de relation avec sa tante ni avec son cousin Émile ingénieur aux chemins de fer. Néanmoins, l’idée de ce cousin ingénieur m’a sans doute aidé dans mon désir de sortir de ma misère sociale.
Dans les petites classes les différences sociales ne comptaient pas beaucoup. Plus tard les choses deviendront plus difficiles. Dans les collectifs d’adolescents autour d’un café, le partage culturel et les éléments de tenue vont creuser le fossé. Pour mes camarades de classe il y avait les boums, le rock et la culture cinéma, autant de choses qui faisaient la différence avec mon milieu de sous-prolétaire. C’était le tournant de la fin des années 60 quand une petite bourgeoisie, nouvelle classe moyenne, s’ouvrait à la culture de masse.
A partir de la seconde je deviens totalement exclu de ce monde par ma relégation à la cité des Sables. Habiter rue Jean Macé ça pouvait se dire et vu de l’extérieur l’endroit paraissait normal. Je n’étais pas obligé d’ouvrir la porte de mon domicile. Mais, habiter la cité des Sables c’était une autre affaire, ça vous classait d’office et sans questions. Je me sentais coincé des deux côtés. J’étais trop réfléchi du côté des Sables et d’un lieu trop inquiétant du côté de mes pairs en classe. A partir de la première, Jacques qui me connaissait bien n’était plus dans la même classe que moi, on se voyait moins souvent.
J’ai eu quelques autres bons amis, notamment un garçon de petite bourgeoisie, Marc D. dont les parents possédaient un particulier tourangeau rue Henri Martin. Notre rencontre avait débuté par une dispute à propos d’une priorité d’accès au robinet à eau pour boire. La confrontation fut courte mais assez vive, elle déboucha sur une bonne relation amicale. Il avait tout ce qu’un adolescent peut souhaiter et voulait bien le partager. Sa mère voyait d’un bon œil le petit groupe autour de son fils venir chez elle. Marc était malade du cœur (tachycardie) bien qu’il fût très sportif. Il pratiquait en outre le chant lyrique. En plus de Jacques qui me suivait toujours il y avait dans ce groupe un autre garçon, Dominique qui habitait la rue Febvotte. Celui-là ne m’aimait pas car il était jaloux de cette nouvelle amitié des deux Marc. Nous avons eu quelques confrontations houleuses.
Jusqu’en 1ère j’étais en classe de M’ parmi le petit nombre qui faisait à la fois des maths et du latin. Nous étions quatre, Jean-Yves, Jacques, Pierre-Antoine et moi. Les compétences requises qui étaient à la fois mathématiques et littéraires ne sont plus associées aujourd’hui. J’en étais très fier car cela me distinguait et d’autre part j’aimais le latin qui aidait à mieux comprendre et apprécier la langue française. Mon année de seconde avait été difficile eu égard aux conditions de travail, seul le professeur de physique en avait tenu compte dans ces appréciations. Cette indifférence m’avait fait perdre le peu de confiance que j’avais dans l’institution scolaire.
Après une fin de parcours scolaire calamiteuse en terminale, en juin 1967, j’ai passé le bac option sciences expérimentales. Je n’avais pas choisi cette option, elle m’avait été imposée par le conseil de classe à la fin de la première. Cela avait été pour moi comme un rejet par l’institution. L’année de terminale fut très difficile en conflit avec le professeur de mathématiques et face à une certaine indifférence des autres professeurs.
Pour le bac 67 les résultats nationaux sont faibles. Il y a beaucoup de recalés, je suis de ceux-là. J’échoue de peu pour une erreur d’une banalité affligeante, une erreur d’addition dans un calcul de probabilités. Le raisonnement était juste mais le résultat était faux, j’ai obtenu 9/20 au lieu d’un 14/20 attendu. Quelle leçon! J’avais 11/20 en philo alors que toute l’année j’étais dans les deux ou trois derniers avec des notes du genre 6/20 et j’échouais en mathématiques mon point fort. En sortant du centre d’examen au lycée Grammont, j’étais pratiquement sûr d’avoir réussi. C’est ce que j’annonçais en rentrant chez moi, je devais déchanter,
Pour les recalés de la session de juin et qui avaient au minimum 7/20, ce qui était mon cas avec 9,5, un rattrapage sur dossier était possible mais le professeur de mathématiques n’aura aucune pitié, je suis recalé! Je devrais aller aux épreuves écrites de rattrapage organisées pour septembre. L’été aurait dû être studieux, ce ne sera pas le cas. Je dois travailler pour rapporter un peu d’argent à la maison et aussi prendre un peu l’air ailleurs. J’irais donc au rattrapage sans trop d’illusions. Ce sera l’échec. Mes parents faute d’argent ne me permettront pas de redoubler. Je vais voir s’éloigner mes rêves d’études. A ce moment, je suis dans le vague et je ne sais que faire. J’ai en poche le certificat de fin d’études secondaires qui atteste d’un niveau bac. Au final l’institution aura eu ma peau, je n’avais pas à être là. Retournes à ta cité, à ta classe sociale.
Fin de parcours
En juillet il me faut trouver un travail et rapporter un peu d’argent à la maison et si je veux partir en vacances. J’ai trouvé de l’embauche dans une fabrique de pains de glace pour réfrigérer les wagons. C’était un travail difficile et très physique. De l’eau est versée dans des moules de vingt cinq litres qui sont plongés dans de la glace pillée mêlée à une solution saline. Après un certain temps, l’eau se prend en glace dans les moules. On les trempe alors dans de l’eau plus chaude et on démoule sur un plan de travail en bois. Chaque pain de glace est alors pris et empilé provisoirement sur une hauteur de deux mètres dans une chambre froide. La saisie des pains de glace se fait avec un crochet dans la main droite et un gant en caoutchouc sur le bras gauche. Lorsque la prise est assurée, on gerbe les pains de glace jusqu’à une hauteur de deux mètres en attente d’être envoyé à la gare et mis dans les wagons réfrigérés de la SNCF ou d’une autre société. C’est un travail à la chaîne, une rangée de moules remplace la précédente et ainsi de suite pendant toute la journée. J’y gagnerai deux centimètres d’avant bras en un mois, tout beau pour partir en vacances. Bien sûr je n’ai pas le temps ni la force de réviser avec des semaines de 45 heures.
En août, avec mon ami Marc, nous avions prévu avant mon échec au bac de partir en vacances. Grâce à mon salaire de juillet dont une partie reviendra à mes parents j’aurai l’autorisation de partir. Nous partons faire du camping au Croisic en bord de mer. Ce fût une aventure mémorable. Nous avions mis tout le matériel dans une très grande valise que nous portions à tour de rôle. Hélas la poignée de la valise nous a lâchés à la gare de St Nazaire. Nous avons continué en fabriquant une sorte de brancard avec deux morceaux de bois pour aller prendre le car qui nous a déposés au Croisic. Le terrain de camping était sympathique mais notre emplacement au milieu du camp nous valait des salutations continuelles et surtout beaucoup de « bon appétit » car nous vivions de manière un peu décalée, couchage tardif et repas vers 14 heures. Ces très belles vacances, les premières depuis plusieurs années, ne vont pas m’aider à réviser ; sans révisions pendant l’été le rattrapage au bac sera bien pire que l’examen de juin. Finies les études, mes parents me confirment qu’ils ne peuvent plus continuer à subvenir à mes besoins et que je dois chercher une situation.
En octobre 1967 je suis à la recherche du travail, l’ami Maurice me recommande pour un emploi d’aide traceur. Je deviens donc aide traceur sur le chantier de construction de la nouvelle gendarmerie de Tours, avenue de Grammont. Je continue de penser aux études et j’envisage toujours une capacité en droit qui me permettrait des études supérieures tout en travaillant. J’étais payé au SMIG (Salaire Minimum Inter-professionnel Garanti) qui sera remplacé en 1970 par le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Au 1er juillet 1967 le SMIG était à 2frs15 de l’heure, il passera à 2frs22 au 1er janvier 1968. Suite aux grèves, le 1er juin 1968 il passe à 3frs, grève générale et Grenelle social obligent. Mais revenons à la construction de la gendarmerie, le salaire était faible mais le travail de traçage n’était pas bien difficile. Hélas le chantier, sous responsabilité de l’armée, dût accueillir un élève officier en stage ; adieu le traçage bonjour le statut de manœuvre maçon si je voulais rester. Je n’avais pas vraiment le choix car il me fallait gagner ma vie. Pendant une demi-journée je remontais les tas de graviers et de sable pour alimenter la bétonnière et l’autre demi-journée je transportais des seaux de mortier dans les échelles jusqu’au sixième étage dans le bâtiment en construction qui n’avait que les murs de côté. L’hiver sur un chantier ouvert à tous vents en tant que manœuvre maçon c’est le cauchemar. Pour le sable et le gravier, je faisais ce travail à l’alternat avec un vieux portugais qui rentrait chez lui le midi pour se restaurer d’une sardine avec des pommes de terre. Nous étions en décembre, il faisait très froid et je rêvais qu’il y ait des intempéries. Mais, il fallait une température inférieure à moins 7 degrés ou de la neige, qui gâte le ciment, pour avoir droit aux « intempéries » qui m’auraient permis de chômer avec un revenu minimum.
Je suis désespéré, la capacité en droit en travaillant s’éloigne, je ne vois pas comment faire en étant manœuvre maçon. Je fais alors ce que beaucoup d’autres fils de familles pauvres ont fait avant moi. Je vais voir l’armée pour m’engager et pouvoir reprendre mes études. J’ai le profil idéal pour être sous officier, mes tests sont excellents et je n’ai pas le sou. L’école de Saint Maixent, une grande famille qui fabrique des sous-officiers, me tend les bras. Le matin où je devais aller signer mon engagement de cinq ans, je reçois une lettre des PTT qui m’informe de mon succès au concours de contrôleur et de ma nomination en stagiaire à partir de janvier. Je suis sauvé par le gong car compte tenu de mon caractère j’aurais sûrement eu des difficultés avec l’armée.
Nous sommes en janvier 1968, j’ai 19 ans et demi. La suite sera une autre vie à inventer.
« On peut avoir sans romantisme la nostalgie d’une pauvreté perdue. Une certaine somme d’années vécues misérablement suffit à construire une sensibilité. »Camus
Publié en auto-édition, dépôt légal décembre 2023